Cet article est la deuxième partie d’une exploration des extrêmes du choc culturel. La première est consacrée à la libération que peut provoquer la rencontre avec une culture très différente.
* * *
“L’Inde, triangle des Bermudes du mental ” (p.12)
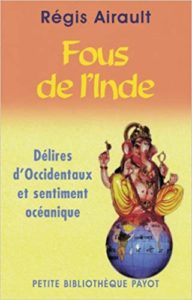 Régis Airault est un médecin psychiatre qui a exercé au consulat de France à Bombay, puis pour des compagnies d’assurances dans le cadre de rapatriements sanitaires. Il a raconté son expérience dans l’ouvrage Fous de l’Inde, Délires d’Occidentaux et sentiment océanique, paru chez Payot en 2000. Il décrit des cas de décompensations psychiques, autrement dit de rupture de l’équilibre psychologique d’une personne, chez des voyageurs occidentaux en Inde :
Régis Airault est un médecin psychiatre qui a exercé au consulat de France à Bombay, puis pour des compagnies d’assurances dans le cadre de rapatriements sanitaires. Il a raconté son expérience dans l’ouvrage Fous de l’Inde, Délires d’Occidentaux et sentiment océanique, paru chez Payot en 2000. Il décrit des cas de décompensations psychiques, autrement dit de rupture de l’équilibre psychologique d’une personne, chez des voyageurs occidentaux en Inde :
« Avec mes collègues psychiatres de l’ambassade, nous nous posions souvent la question : « L’Inde rend-elle fou, ou les fous vont-ils en Inde ? », surpris par la fréquence de ces épisodes psychiatriques traversés par les voyageurs. » (p.14)
Ces voyageurs en crise sont en proie à une déréalisation (une partie de la réalité devient étrangère à sa propre personne) ou à une dépersonnalisation (une partie du moi devient étrangère à soi-même), accompagnées d’anxiété, attaques de panique, dépression, hallucinations, délires, crises mystiques. lls peuvent être réunis sous trois grandes catégories :
- Les personnes ayant déjà une fragilité au départ, parfois avec des addictions aux stupéfiants, dont le voyage peut être motivé par le délire et dont la crise survient à l’arrivée : on parle alors de voyage pathologique.
Ainsi, certains quittent brutalement leur cadre habituel en France et, dès leur arrivée en Inde, ils déchirent leur passeport et ne donnent ensuite plus signe de vie à leur famille pendant des années, vivant dans un éternel présent, entre toxicomanie et vision mystique du monde.
- Les personnes n’ayant pas de fragilité au départ, sans antécédent de consommation de stupéfiants, dont la crise délirante survient après quelques semaines de séjour : le voyage est alors pathogène.
Régis Airault évoque le cas de Chantal, 22 ans, amenée en consultation par l’amie qui voyage avec elle car, en proie à un délire de persécution, craignant qu’on ne lui vole sa pensée et se pensant investie d’une mission, elle a failli se noyer en cherchant à rejoindre ses parents en France à la nage. (p.63)
- Les personnes résidant en Inde (les expatriés), dont les délires sont « beaucoup plus modestes, avec au premier plan une surestimation d’eux-mêmes et un sentiment d’ennui » (p.112), et qui peuvent être victimes de mégalomanie (ivresse de puissance procurée par le statut et les finances), dépression, hypocondrie, délire de persécution.
Contrairement aux deux catégories précédentes, ces personnes n’ont pour la plupart pas choisi de venir en Inde. Les expatriés vivent souvent en communauté d’étrangers, se réfugient dans le travail, quitte à le surinvestir, dans l’attente des prochaines vacances où ils pourront quitter l’Inde, de telle sorte qu’ils ne rencontrent pas vraiment le pays et ses habitants hors du cadre professionnel.
Or, ce qui surprend à la lecture des cas recensés par Régis Airault, c’est autant l’intensité de la crise délirante que, quasiment pour tous, la résolution de la crise avec le retour en France. Revenant « chez eux », ces patients se retrouvent en général eux-mêmes et récupèrent l’équilibre psychique qui avait été mis en péril lors du voyage en Inde.
Ainsi, rentrée en France, Chantal « va bien, mais ne comprend toujours pas ce qui a pu lui arriver » (p.66) De même, Christine, 33 ans, sans antécédent psychiatrique, ne prenant pas de substance toxique, mais dépressive depuis son arrivée en Inde, insomniaque, suicidaire, en proie à des crises qui la font s’allonger les bras en croix sur le bitume, rejetant cet « affreux pays » où elle est venue avec des amies, est rapatriée pour être hospitalisée, ce qui s’avèrera inutile « vu l’absence de troubles à l’arrivée » (p.79), comme si le déraillement produit par la rencontre avec le contexte indien trouvait sa résolution dans les retrouvailles avec les rails culturels familiers.
Un choc culturel extrême
Le choc culturel n’est pas un choc des cultures, mais l’expérience d’une personne se trouvant immergée dans une culture étrangère. Elle rencontre alors des pratiques, des us et coutumes, des relations aux autres et au monde, des valeurs, un contexte social, historique, spirituel, politique, etc., qui peuvent être un peu, voire totalement différents, de son contexte d’origine. En Inde, cette expérience se vit dans les extrêmes :
« Plus qu’ailleurs, le voyageur est soumis, lors de son arrivée en Inde, à un choc culturel qui semble obéir à la loi du « tout ou rien » : c’est la séduction ou la répulsion, car, dit-on, on ne frappe pas à la porte de l’Inde : on est aspiré ou rejeté. Chacun réagit selon sa personnalité et ses mécanismes de défense. » (p.66)
Les différences expérimentées dans le choc culturel peuvent ainsi séduire à l’excès, cf. les témoignages de la p.68 :
- « J’ai dû vivre ici dans une vie antérieure. »
- « Me revoici chez moi. »
- « Je foulais pour la première fois le sol de l’Inde. En sortant de l’avion, l’émotion m’envahissant était si forte que je me baissais pour embrasser la terre. C’était comme un instant de connivence avec l’invisible. »
Mais elles peuvent aussi entraîner une forte répulsion, voire un rejet immédiat qui se manifeste parfois dès l’arrivée à l’aéroport. Ainsi, Régis Airault évoque des voyageurs qui se figent avant même de passer la douane ou s’enferment dans leur hôtel pour n’en plus ressortir de leur séjour.
Dans les deux cas, séduction ou répulsion extrêmes, il semble que l’individu ne parvienne pas à trouver un équilibre quelconque, comme si sa psychologie basculait en permanence d’un plateau à l’autre de la balance :
« Plongés sans repère dans un tourbillon de misère, de surpopulation, d’images et de dieux inconnus, on n’y comprend plus rien. Ces moments d’angoisse intense se teintent parfois de somatisations (plaintes corporelles) ou de sitiophobie (peur d’attraper une maladie). D’autres personnes peuvent présenter un état d’euphorie avec un sentiment de toute-puissance, ou au contraire un tableau dépressif avec des idées de ruine. » (67-68)
Si l’on applique à la psychologie une analogie avec la circulation routière, on peut se demander ce que l’arrivée en Inde produit sur le psychisme quand on vient d’un environnement tel que, par exemple, celui-ci (séquence filmée à Amsterdam) :
Et qu’on se trouve immergé dans un environnement très différent, qui lui aussi à ses propres règles mais que, sans préparation ni temps de décryptage, on vit dans une complète désorientation, livré à un chaos apparent dont rien ne rassure, où s’exacerbe la perte des repères sur le mode de l’anxiété extrême:
.
L’échec d’une rencontre
Ce qui frappe à la lecture des cas et témoignages réunis par Régis Airault, c’est la quasi absence des Indiens, comme si ces voyageurs étaient plus confrontés à eux-mêmes qu’aux Indiens en tant que tels. C’est le cas de Christine (mentionnée plus haut) qui, rentrée en France, écrit une lettre à son médecin pour essayer de comprendre ce qu’elle a vécu :
« Que s’est-il passé à Bombay ? Les derniers jours, je n’étais plus moi-même, incapable de réagir. J’ai pris peur, peur de ce monde dont je ne connaissais ni la langue, ni la façon de vivre. Ne pouvant pas communiquer, j’ai été prise de panique. » (p.79)
Au sein de la communauté des expatriés, on constate une semblable absence de connexion avec le contexte indien :
« La majeure partie de cette population rejetait le pays en bloc. […] Pour eux, l’adaptation est difficile, en particulier s’ils habitent Bombay, ville bruyante et surpeuplée. Ils ne peuvent pas profiter de l’Inde durant leurs deux mois de congés annuels, puisqu’ils rentrent alors en France. […] Ces difficultés d’adaptation des expatriés étaient souvent à mettre en relation avec le climat, les problèmes relationnels avec les « locaux », et la fuite en avant dans le travail. […] Certains sombraient peu à peu dans une dépression « légitime », l’Inde devenant un « objet poubelle » opposé au sujet occidental parfait. » (pp.111-113)
Je cite ce long extrait car il décrit parfaitement ce que j’ai pu observer lors de deux séjours d’expatriation en Arabie saoudite. La différence avec le contexte indien, c’est que l’Arabie était généralement objet de répulsion, quasiment jamais de séduction. La chaleur extrême, l’environnement désertique, la sensation de vide qu’il procure par contraste avec le trop-plein des villes, la circulation routière, l’enfermement dans les « compounds (complexes résidentiels ultrasécurisés et interdits aux Saoudiens), la présence permanente de la religion, les interdits majeurs, la frontière entre espace public et espace privé, la séparation hommes/femmes, une société fortement inégalitaire, le comportement envers les femmes, les minorités, les étrangers venus des pays pauvres, l’exhibition outrancière de la richesse, etc., entraînent agacement, énervement, colère, puis jugement de valeur et incompréhension, enfin répulsion profonde et désir de fuite (dans le travail en attendant les congés, à l’étranger dès que possible).

Ainsi, j’ai rencontré des Français, mais aussi des Européens et Américains qui n’avaient jamais tissé de liens sociaux avec des Saoudiens. Il y avait même de la suspicion de leur part si vous aviez des connaissances, et encore plus des « amis » saoudiens. Pour ma part, j’avais la chance lors de mon premier séjour de donner des cours de langue et culture françaises aux Saoudiens, et donc d’accéder en classe ou en cours privés à toutes les couches de la société, depuis le fils de bédouin jusqu’à la famille royale. Ces moments privilégiés, prolongés par des échanges chez eux, au restaurant, dans des cafés, dans le désert ou au bord de la mer Rouge, permettaient d’entrouvrir ce qui pour la plupart des étrangers resté fermé durant tout leur séjour dans un pays aussi méconnu à leur départ qu’à l’arrivée.
Et, oui, comme le raconte Régis Airault, j’ai vu des Français s’effondrer en Arabie saoudite, un pays où, comme l’avers et le revers d’une même médaille, la vie souterraine, informelle, clandestine où l’on s’affranchit des règles sociales et morales, est aussi présente que la vie publique, formelle, cadenassée d’interdits. Divorces, alcoolisme, conduite addictives, dépressions, dérives racistes, obsessions de l’argent, crises délirantes, reports de consultation médicale car « on n’a pas le temps », mais aussi un mort : le directeur des opérations de l’entreprise pour laquelle je travaillais lors de mon deuxième séjour, soumis à une pression extrême, livré comme tant d’autres à une fuite en avant dans le travail, foudroyé par une crise cardiaque à la Mecque.

Le dilemme vie rêvée/vie réelle
Finalement, il n’y a rien de plus difficile que de rencontrer la réalité. On se confronte toujours et avant tout à soi-même dans l’expérience d’immersion à l’étranger. Le défi est toujours double : on apprend tout autant à connaître une culture étrangère qu’à se connaître soi-même. Mais il y a une priorité: si on ne se connaît pas soi-même d’abord, on risque de projeter sur la réalité extérieure ce que l’on est, en prenant le vécu subjectif pour la réalité objective.
C’est un risque contre lequel il faut être prévenu. Quelle est par exemple la raison du départ ? En ce qui concerne l’Inde, Régis Airault met en avant le désir de certains de faire l’expérience d’un dépaysement total, pour mettre à distance une réalité française (ou occidentale) avec laquelle ils sont en conflit :
« Les Occidentaux ont toujours recherché là-bas un dépaysement total et cela ne va pas sans risque pour leur équilibre psychique. » Notre réalité « s’étiole si nous sommes trop brutalement ou trop longtemps exposés à un univers symbolique très différent du nôtre. » (p.215)
Il explore alors une piste intéressante : il y aurait un fantasme indien pour les Occidentaux comme il y a un fantasme français pour les Japonais, ou religieux pour les Chrétiens qui vont à Jérusalem ou pour les Musulmans qui vont à la Mecque, d’où le syndrome dit « de Paris » (choc culturel de la réalité parisienne décevante pour des Japonais ayant fantasmé la réalité parisienne), ou syndrome religieux qui entraîne des crises mystiques chez certains croyants en pèlerinage :
« Il semble que les voyageurs « agissent » et mettent en acte le fantasme qui anime leur culture et leur histoire : Paris et la civilisation européenne pour les Japonais, l’Orient et sa sagesse pour le Français. Dans les deux cas, il s’agit d’une vision romantique de cet « ailleurs ». Ces décompensations ne sont donc pas simplement dues au climat, au mysticisme ambiant, ou à la drogue, mais au fait que notre réalité est sous la dépendance de l’univers symbolique qui nous détermine et des fantasmes qui nous animent. Si nous sommes trop longtemps exposés à un univers trop différent du nôtre, cette réalité « se défait, et ce, d’autant plus que le pays, objet du voyage, occupe une position mythique dans la culture d’origine. » (p.106)
Il faut donc se méfier de notre propre univers fantasmatique, de tout ce qu’on associe à un lieu sur le registre du « mystère », de « l’aura », de « l’authenticité », du « retour aux origines », de la « communion avec l’humanité », etc. Or, tout conspire autour de nous à alimenter ce devenir-exotique de l’ailleurs. Ainsi, on peut déplorer qu’actuellement sur le site internet d’Arte une série documentaire sur l’Arabie en alimente la perception fantasmatique en mettant en avant sa dimension “mystérieuse”:
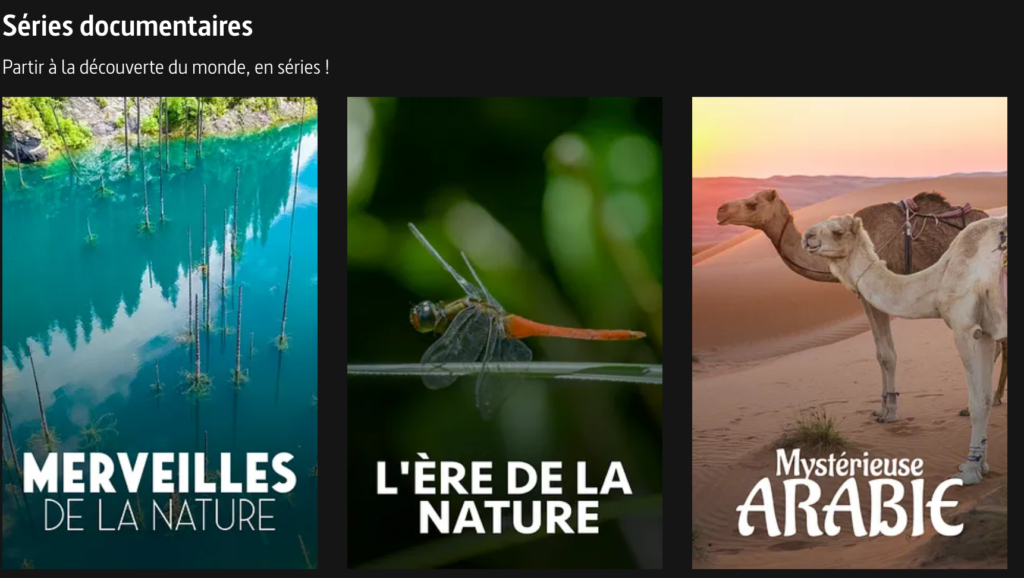
Il ne s’agit pas de retirer du charme au monde mais de prendre garde à ce que ce charme n’envahisse pas l’univers perceptif jusqu’à lui retirer sa propre poésie pour lui substituer son délire personnel. Entre ceux qui se perdent dans une rencontre fantasmatique et ceux qui passent à côté de la réalité dans une fuite en avant, par exemple dans le travail, c’est une ligne de crête aussi difficile qu’essentielle à tenir.
Pour prolonger, je vous invite à consulter sur ce site:
- Le témoignage d’Antoine Schmitt en section commentaire de cet article
- La première partie de l’article consacrée à la libération par le choc culturel
- Paris: l’imaginaire des Japonais et la réalité
- Travailler avec les Français: des Indiens témoignent
* * *
- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?
- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?
- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.
Quelques suggestions de lecture:
- Promenade aux deux pôles du choc culturel (1) : libération
- L’interculturel à travers l’histoire : 5 articles à lire à la plage ou… au bureau
- Le paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence culturelle – entretien pour le Centre Algérien de Diplomatie Economique
- Expatriés sur place!
- 4 exemples d’exotisme linguistique (petites laideurs et grosses erreurs)
- Gestion des Risques Interculturels – 6 articles de 2013


Je vous invite à prendre connaissance ci-dessous du témoignage que m’a confié un ami, Antoine Schmitt, qui a voyagé pendant deux mois en Inde. Merci à lui d’en avoir autorisé la publication.
* * *
En Inde, il y a une bienveillance envers ce qu’en Occident on considèrerait comme des marques de folie qui peut fasciner, voire faire basculer: je me souviens par exemple de ce type, dont les yeux bleus et les cheveux couleur paille laissaient penser qu’il était d’origine germanique ou scandinave: il avait surgi dans une rue de Mahabalipuram, une petite ville du Tamil Nadu célèbre pour ses grottes sculptées: pieds et torse nus, son chignon, sa flûte et sa façon de gambader par petits bons, il évoquait “Krishna dansant”, l’un des avatars de Vishnou (bien qu’il ne portât pas une peau de léopard autour de la taille, mais un short effiloché).
Sans aller vers ces extrêmes, l’indifférence à l’accoutrement d’autrui, combiné a des températures élevées donnent parfois un relâchement complet chez les touristes, surtout ceux du type “routards”: l’un d’entre eux, depuis trois mois en Inde, me raconta qu’il “adorait ce pays: on peut y faire tout ce qui est mal vu en Occident, cesser de se laver, se laisser pousser les cheveux et la barbe, manger avec ses doigts, se torcher le cul avec sa main” alors qu’il touillait a deux mains un plat de riz en sauce dont les grains collaient a sa barbe hirsute. L’autre extrême se rencontre également, telle cette infirmière de profession qui s’épouvantait que je me rende régulièrement chez le barbier, m’expliquant que la moindre coupure pourrait m’inoculer des bactéries mangeuses de chair qui nécroseront mon visage. Autre exemple : cette fille qui avait épousé un Indien d’Udaipur, ne mangeait plus qu’indien, s’habillait uniquement en sari, prétendait avoir sans doute été indienne dans une autre vie – et qui m’avait dit qu’elle détestait revenir en France, car tout le monde la regardait.
Un ami m’avait averti avant que je ne parte pour l’Inde : “tu verras, tout y amplifié”. Pas dans le sens “plus grand” : les villes indiennes ne montrent pas de proportions gigantesques, pas de places immenses comme à Pékin et même le Taj Mahal semble à taille humaine. Cela vient sans doute du fait que l’Inde n’a jamais été un État centralise, ou l’autorité devait se montrer, se faire écrasante. Mais tout est plus intense : les températures, les bruits, les odeurs, la foule – au point qu’une simple promenade peut donner le sentiment de subir de multiples agressions.
Mon avion atterrissait à Mumbai au petit matin. La chaleur, humide, poisseuse, est ce qui frappe d’emblée lorsqu’on sort de l’aéroport. Je ne voulus pas prendre de taxi, et c’est ainsi que je me retrouvai dans un de ces trains de banlieue si bondés, qu’il n’y a pas de portes mais des lanières au plafond pour s’accrocher. Il me fallut enjamber une famille dormant à même le sol pour atteindre la porte de mon hôtel. Un chat pelé à qui il manquait un œil était couché dans un coin. Je déposai mes bagages, pris une douche, sortis. Un boucher venait d’égorger un mouton qu’il vidait de son sang dans le caniveau. L’odeur était animale, chaude, presque palpable. La tête trainait sur le trottoir – j’en verrai d’autres, empilées, au temple de Kali à Kolkata.
Je passai devant un petit temple justement – d’où émanaient des effluves d’encens. Puis juste après un tas d’ordures qui pourrissaient au soleil. Plus tard, je sentirai quelque chose de chaud sur mes pieds : une chèvre qui urinait. Et en essayant de rentrer à l’hôtel, je me perdis dans une foule compacte, le trottoir était si encombré qu’il fallut marcher sur l’asphalte. Lorsque je fus dans ma chambre, je me couchai sur le lit, les yeux grands ouverts, et je passai plusieurs minutes à regarder les pales du ventilateur brasser l’air lourd, à me demander ce que je ferais si je ne supportais pas ce pays où j’étais censé passer deux mois.
Au-delà de ces sensations, ce qui peut faire basculer nos esprits pétris de rationalisme est cette ferveur religieuse et cette violence qu’on sent contenue mais prête à jaillir. Ainsi au temple de Madurai, l’un des plus vastes du sud de l’Inde : les cérémonies indiennes sont bruyantes, pleines d’encens et de fleurs, comme celle du réveil de la divinité au temple de Maddurai, l’un des plus vastes du sud de l’Inde : la foule tournait autour du Shiva linga, le phallus de Shiva, une colonne d’or qui traverse le toit. Les deux battants d’une porte de bronze s’ouvrent, entre un éléphant caparaçonné de broderies et sequins. La foule se presse, s’agenouille pour qu’il lui touche le front de sa trompe. Je dus sortir m’asseoir au calme.
On a également de l’Inde l’image d’une société non violente, à l’image de la doctrine défendue par Gandhi. Au contraire, la violence est partout : elle suinte dans les rapports entre maîtres et serviteurs, dans ces billets sales jetés à la face d’un chauffeur de rickshaw, dans le contraste entre des Brahmanes tout de blanc vêtus dans un rickshaw tiré par un homme efflanqué dans une rue boueuse. Dernière anecdote : cet Espagnol adepte du yoga, que je rencontrai à Varanasi, qui affichait tant de spiritualité par la parole, paniqua littéralement à la vue d’un cadavre qu’on était en train de brûler sur un bûcher le long du Gange.