A deux reprises, dans Le point de vue de l’autre : angle mort des relations interculturelles ? et 5 questions à (se) poser avant une rencontre professionnelle interculturelle, je me suis penché sur cette difficulté, voire réticence, à prendre en compte le point de vue de l’autre dans le contexte professionnel.
Cette situation de résistance m’interroge de plus en plus dans la mesure où, formation après formation, année après année, je réalise qu’un des obstacles majeurs à l’entente interculturelle tient au mur parfois infranchissable du point de vue de chacun : bien au chaud derrière notre manière de voir et de faire, on n’ose pas aller au-delà, réflexe navrant mais généralisé, quel que soit le contexte culturel.
Le hasard de mes lectures m’a replongé dans ce problème. Je vais m’appuyer sur celles-ci pour quitter le plan de l’anecdote et prendre un peu de hauteur et tenter d’inscrire ce phénomène dans un mouvement plus vaste et plus ancien.
Ethnocentrisme généralisé
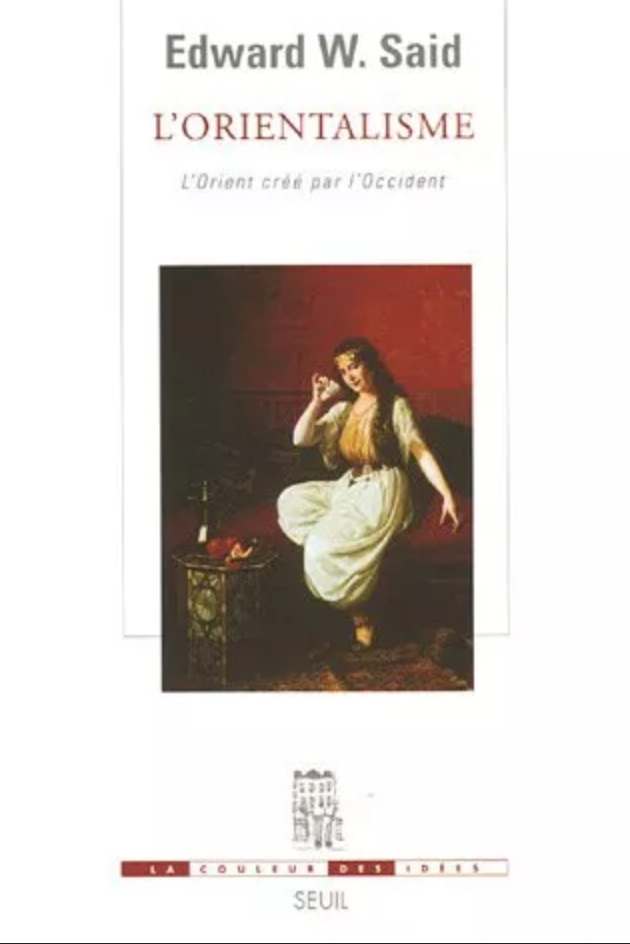 Le point de départ de cette exploration m’a été donné par ma lecture récente de l’essai d’Edward Saïd, L’Orientalisme (sous-titré : L’Orient créé par l’Occident), un classique que je me promettais de lire depuis plus de dix ans… En p.285 (Seuil), Saïd évoque le philosophe français Étienne Gilson, spécialiste de philosophie médiévale [oh surprise de voir rejaillir ce nom que je n’avais pas lu depuis mes lointaines études de philosophie !]. Plus précisément, Saïd mentionne le livre qu’un critique anglais, Ivor Armstrong Richards, a écrit sur le philosophe chinois Mencius (publié en 1932), et dans lequel est citée une remarque d’Étienne Gilson affirmant que Thomas d’Aquin « accepte et réunit la totalité de la tradition humaine ». Richards réagit alors de la manière suivante :
Le point de départ de cette exploration m’a été donné par ma lecture récente de l’essai d’Edward Saïd, L’Orientalisme (sous-titré : L’Orient créé par l’Occident), un classique que je me promettais de lire depuis plus de dix ans… En p.285 (Seuil), Saïd évoque le philosophe français Étienne Gilson, spécialiste de philosophie médiévale [oh surprise de voir rejaillir ce nom que je n’avais pas lu depuis mes lointaines études de philosophie !]. Plus précisément, Saïd mentionne le livre qu’un critique anglais, Ivor Armstrong Richards, a écrit sur le philosophe chinois Mencius (publié en 1932), et dans lequel est citée une remarque d’Étienne Gilson affirmant que Thomas d’Aquin « accepte et réunit la totalité de la tradition humaine ». Richards réagit alors de la manière suivante :
C’est ainsi que, tous, nous raisonnons ; pour nous, le monde occidental est toujours le Monde ; mais un observateur impartial dirait peut-être que ce genre de provincialisme est dangereux.
Provincialisme, ou bien ethnocentrisme, et plus précisément encore : eurocentrisme. Ici, Étienne Gilson identifie la tradition humaine à la pensée de Thomas d’Aquin, et réduit ainsi le monde au Monde européen. Étienne Gilson pouvait-il ignorer qu’en dehors de la pensée européenne, il existe des philosophies juive, arabe, chinoise, indienne ? Pourquoi ne pas parler plutôt de « tradition européenne » ? Pourquoi en quelques mots effacer tout autre point de vue sur la « tradition humaine » ?
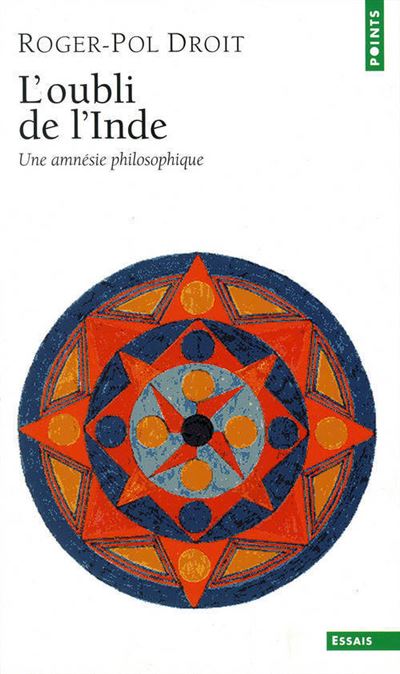 En 1989, Roger-Pol Droit fait un constat identique dans son livre L’oubli de l’Inde, Une amnésie philosophique :
En 1989, Roger-Pol Droit fait un constat identique dans son livre L’oubli de l’Inde, Une amnésie philosophique :
Considérons la formation philosophique dispensée dans nos établissements d’enseignement ? Des classes terminales à l’agrégation, aucun programme national ne mentionne jamais un auteur non européen. […] Tenons-nous à cette première évidence : la philosophie qu’on enseigne est, de fait, européenne. Rien qu’européenne. (p.3
En 2005, le prix Nobel d’économie indien Amartya Sen publie La démocratie des autres Payot), où il fait le même constat en ce qui concerne la pensée politique :
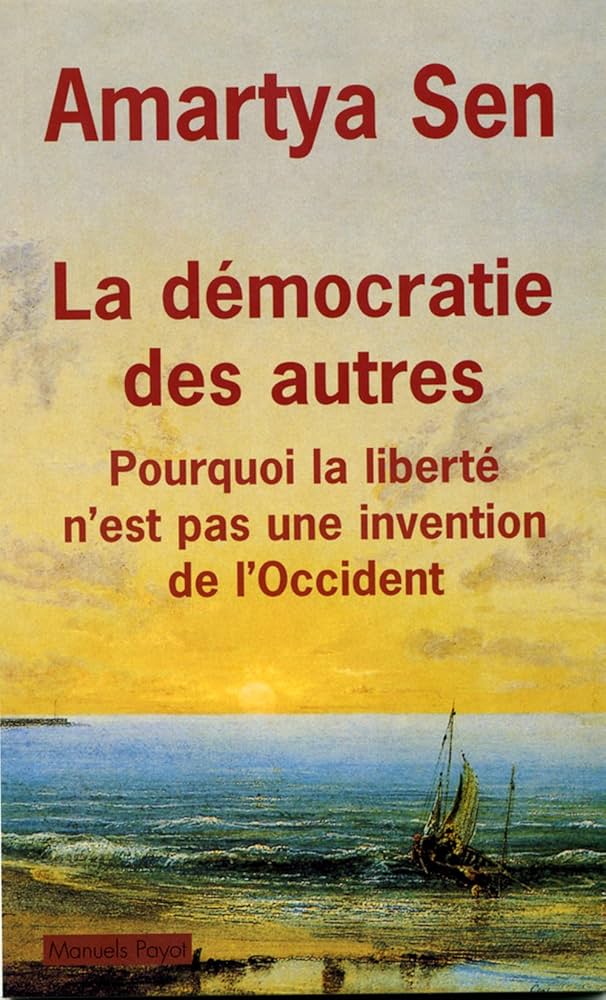 Tous les écrits sur l’histoire de la démocratie sont pleins de contradictions célèbres entre Platon et Aristote, Marsile de Padoue et Machiavel, Hobbes et Locke, et ainsi de suite. Qu’il en soit ainsi est normal ; mais les immenses héritages intellectuels de la Chine, du Japon, de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, du sous-continent indien, de l’Iran, du Proche-Orient et de l’Afrique, ont été presque entièrement négligés dans l’analyse de ce que fut la portée de l’idéal du débat public. (p.25)
Tous les écrits sur l’histoire de la démocratie sont pleins de contradictions célèbres entre Platon et Aristote, Marsile de Padoue et Machiavel, Hobbes et Locke, et ainsi de suite. Qu’il en soit ainsi est normal ; mais les immenses héritages intellectuels de la Chine, du Japon, de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, du sous-continent indien, de l’Iran, du Proche-Orient et de l’Afrique, ont été presque entièrement négligés dans l’analyse de ce que fut la portée de l’idéal du débat public. (p.25)
La thèse de l’exception européenne dans le respect de la tolérance et du dialogue ne peut être soutenue qu’en fermant les yeux sur tous les exemples de débats publics historiquement attestés dans d’autres régions de notre planète. (p.33)
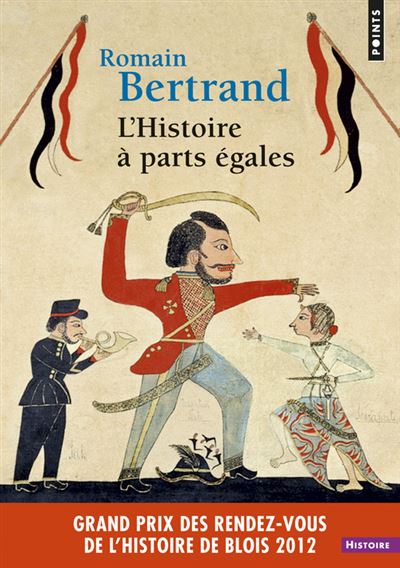 Dans sa vaste et passionnante fresque de 2011, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre, Orient-Occident, XVIe-XVIIe siècle (Points Histoire), l’historien Romain Bertrand rejoint le constat de Richards en 1932 :
Dans sa vaste et passionnante fresque de 2011, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre, Orient-Occident, XVIe-XVIIe siècle (Points Histoire), l’historien Romain Bertrand rejoint le constat de Richards en 1932 :
Si nous connaissons sur le bout des doigts la litanie des “grands hommes” de la modernité européenne, nous sommes incapables de citer ne serait-ce qu’un nom de penseur malais, moghol ou chinois. […] Ce n’est plus de mépris, c’est d’oubli de l’Autre dont il est question. Nous professons doctement l’égale dignité des “civilisations”, mais ne célébrons qu’un seul Panthéon de la pensée. (p.12)
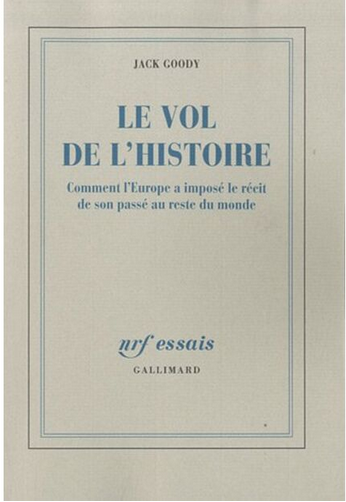 Enfin, je terminerai ce rapide tour d’horizon en rappelant que le nombrilisme n’est pas un privilège occidental. Dans Le Vol de l’histoire, sous-titré Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, l’anthropologue britannique Jack Goody note ainsi que « si l’Europe n’a pas inventé l’amour, la démocratie, la liberté ou le capitalisme de marché, elle n’a pas non plus inventé l’ethnocentrisme » et précise qu’il s’agit là d’un « phénomène général » (p.19).
Enfin, je terminerai ce rapide tour d’horizon en rappelant que le nombrilisme n’est pas un privilège occidental. Dans Le Vol de l’histoire, sous-titré Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, l’anthropologue britannique Jack Goody note ainsi que « si l’Europe n’a pas inventé l’amour, la démocratie, la liberté ou le capitalisme de marché, elle n’a pas non plus inventé l’ethnocentrisme » et précise qu’il s’agit là d’un « phénomène général » (p.19).
Le « désolant travail d’élimination » de Gombrich
Après m’être replongé dans les ouvrages précédents où les passages cités m’ont sauté aux yeux bien plus qu’au moment de leur première lecture (un effet grossissant certainement dû aux innombrables témoignages et anecdotes recueillis en animant des formations interculturelles), j’ai relevé la tête et regardé avec suspicion ma propre bibliothèque. Et si ?… Et si certains de ces ouvrages lus, aimés, relus, conseillés, offerts, n’étaient pas également sujets à cette dérive ethnocentrique ?

Immédiatement sur ma gauche et à portée de main se trouvent des livres de poésie, sur l’art et l’esthétique (le management et ses délices sont bien sûr relégués dans un coin obscur du bureau). J’ai donc attrapé ma très vieille édition de l’Histoire de l’art du grand Ernst Gombrich, publiée pour la première fois en 1950. La mienne date de 1967 mais nous en sommes en France à la 16e édition (en photo ci-dessous) et l’ouvrage est toujours considéré comme une des meilleures introductions à l’histoire de l’art.
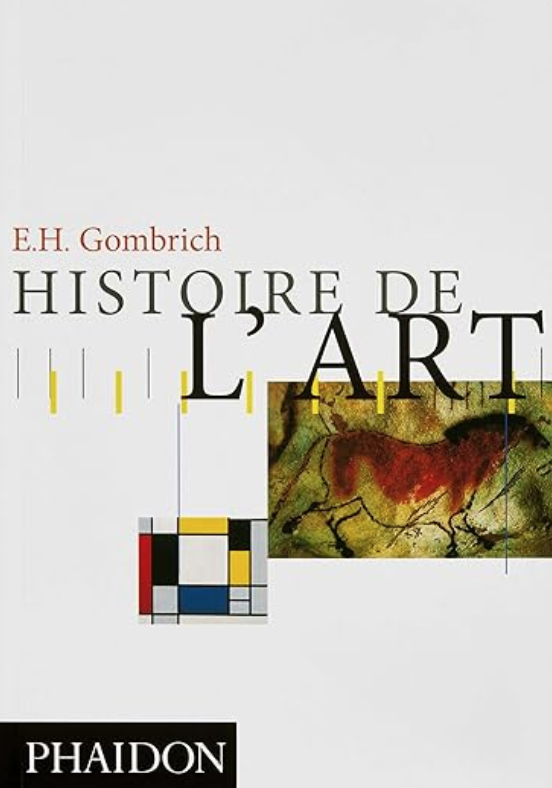
J’ai donc relu l’ouvrage, avec cette fois-ci une attention particulière au point de vue de l’auteur. Et ce que j’ai lu est doublement désolant, d’une parce que j’ai vu désormais l’ethnocentrisme d’Ernst Gombrich jaillir comme un diable hors de sa boîte, d’autre part parce que j’ai réalisé que je n’y avais pas prêté attention la première fois que je l’ai lu il y a de nombreuses années, et que j’étais donc alors tout aussi disposé à adopter ce point de vue ethnocentrique sans en avoir même conscience.
Conformément au titre de son ouvrage, Gombrich annonce une histoire de l’art dans son introduction :
Dans les chapitres qui vont suivre, je me propose d’exposer l’histoire de l’art. (p.40 de ma vieille édition)
Une histoire de l’art. Pas de l’art occidental ou de l’art européen, mais de l’art tout court.
Cependant, dans la Préface (p.9), Gombrich confie avoir rencontré une difficulté. Il a dû « renoncer » à de nombreux artistes, faute de place. Mais aussi à « l’art étrusque », « l’art hindou ». Bref – et il s’en excuse auprès du lecteur – il a dû effectuer un « désolant travail d’élimination » (p.10).
L’art peut-il débuter ailleurs qu’en Europe ?
Pour autant, l’art non occidental a-t-il été éliminé de son histoire de l’art ? Pas vraiment. Sur les 28 chapitres que comporte le livre, le deuxième mentionne l’Égypte, la Mésopotamie et la Crète mais c’est dans la mesure où Gombrich va repérer une continuité menant vers la Grèce et l’Europe :
Une certaine forme d’art existe dans chaque coin du monde, mais l’évolution de l’art, envisagé comme un effort suivi, ne débute ni dans les cavernes du Sud de la France ni parmi les Indiens d’Amérique du Nord. (p.64)
Est-ce que je surinterprète si je comprends qu’une « certaine » forme d’art n’est pas tout à fait l’art ?
Pourtant, d’autres « coins du monde » vont être mentionnés au septième chapitre. Il s’intitule Regard vers l’Est et il est consacré à l’art non européen du IIe au XIIIe siècle : en fait à l’art islamique (2 courtes pages) et à l’art chinois (12 pages dans ma vieille édition de poche en deux volumes). Voici comment ce chapitre est introduit (je souligne) :
Nous ne raconterons pas plus avant les péripéties de l’histoire de l’art en Europe sans jeter au moins un coup d’œil sur ce qui se passait dans les autres régions du monde, au cours de ces siècles troublés. (p.166)
Notons que l’histoire de l’art est devenue l’histoire de l’art « en Europe ». Il y a ici une ambiguïté qui n’est en réalité qu’une coïncidence qui ne dit pas son nom : l’histoire de l’art est d’abord et avant tout une histoire de l’art européen. En lisant cet étrange chapitre, on a bien l’impression qu’il s’agit d’un simple « coup d’œil » (« ein Blick » en allemand), une sorte de salut rapide depuis la vieille et vénérable Europe, un geste presque de politesse envers l’art islamique et l’art chinois avant de revenir aux choses sérieuses, autrement dit à l’art européen.
Pourtant, Gombrich ne peut pas expédier l’art chinois sans faire une concession majeure, essentielle même, car elle casse la coïncidence repérée précédemment et elle déplace fondamentalement le centre de gravité de son projet :
Les Chinois ont été les premiers à voir dans le travail de l’artiste autre chose qu’une tâche quasi servile et à mettre le peintre sur le même plan que le poète. (p.173)
Nous n’en saurons pas plus. Il n’apporte ni précision ni développement à cette concession pourtant capitale. Ce n’est pas faute de connaissances (l’art chinois est bien connu en 1950), mais le point de vue résolument européen de Gombrich l’empêche de le faire : l’art n’a pas pu commencer en Chine. Quelle continuité établir en effet entre l’art chinois et l’art européen si l’on pense ce dernier comme l’accomplissement et l’aboutissement de l’art tout court ? Aucune, dans le cadre du projet de Gombrich : l’art chinois et l’art européen se sont développés dans l’ignorance l’un de l’autre jusqu’à une période très récente. On se demande alors : mais que vaut le monde de l’art chinois pour Gombrich ?
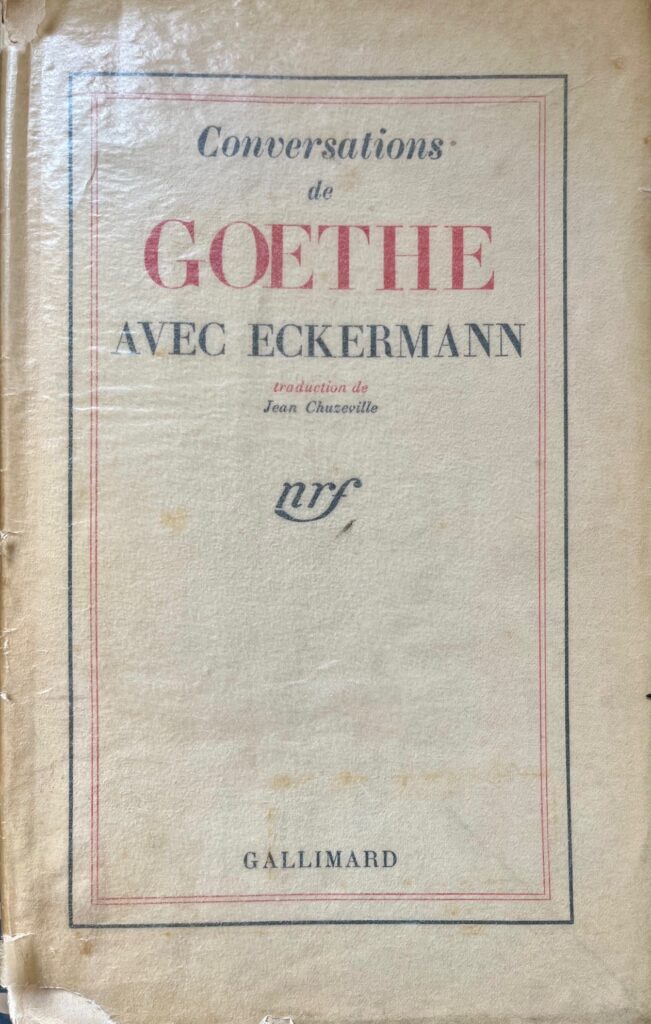 On trouve une concession semblable chez Goethe, quand il raconte à Eckermann combien il a été surpris de se découvrir de nombreuses affinités avec un roman chinois qu’il vient de lire. Eckermann lui demande alors si ce roman est l’un des plus exceptionnels, ce à quoi Goethe répond (pp.157-158 de ma vieille édition Gallimard de… 1941) :
On trouve une concession semblable chez Goethe, quand il raconte à Eckermann combien il a été surpris de se découvrir de nombreuses affinités avec un roman chinois qu’il vient de lire. Eckermann lui demande alors si ce roman est l’un des plus exceptionnels, ce à quoi Goethe répond (pp.157-158 de ma vieille édition Gallimard de… 1941) :
– Pas du tout, les Chinois en ont des milliers de ce genre, et même ils en avaient déjà quand nos ancêtres vivaient encore dans les bois.
Pourtant, même s’il note à propos des romanciers chinois qu’on s’aperçoit “très vite qu’on est semblable à eux”, cette proximité n’entraîne pas une communauté. Goethe referme la porte entr’ouverte pour maintenir à sa place le centre de gravité de son univers esthétique, c’est-à-dire les Grecs :
– Tout en appréciant ce qui nous vient de l’étranger, nous ne devons pas nous mettre à sa remorque ni le prendre pour modèle. Ne croyons pas que ce qu’il nous faut soit chinois, ou serbe, soit Calderon ou les Nibelungen ; mais quand nous avons besoin d’un modèle, nous devons toujours recourir aux anciens Grecs, dans les œuvres de qui l’homme est représenté en ce qu’il a de plus beau.
Plus d’un siècle plus tard, Gombrich s’inscrit toujours dans cette tradition d’eurocentrisme, ou de “grécocentrisme”. Si, en revanche, il partait de l’universalité de l’expérience artistique comme fait humain, qui nous rend semblables dans ce même besoin de beauté et d’émotion esthétique, et qu’il se proposait d’en faire l’histoire, alors peut-être l’art chinois (et islamique, et hindou, etc.) trouverait une autre place dans son ouvrage.
A ce titre, il serait instructif de savoir quelle lecture un Chinois fait-il de l’ouvrage de Gombrich (comment perçoit-il ce septième chapitre « Regard vers l’Est » ?) – mais aussi de lire une histoire de l’art écrite par un Chinois, et de découvrir une autre forme de récit (très probablement tout aussi ethnocentrique que Gombrich) décrivant plus de vingt-deux siècles d’histoire. Quelle place, quelle valeur accorde-t-il à l’art européen ? A quelle « désolante élimination » procède-t-il ?

Un universel bien particulier
Je ne pensais pas effectuer un si long détour par l’ouvrage de Gombrich. Mais en le relisant attentivement, je suis frappé par cette tension entre la dimension européenne de son histoire de l’art et cet effort permanent pour justement la déseuropéaniser, autrement dit, pour l’universaliser (en faisant le saut de l’art européen à l’art tout court). Quitte à effectuer un « désolant travail d’élimination » d’autres histoires, pratiques, sensibilités, patrimoines, artistiques.
Pour illustrer cette tendance européenne consistant à prendre son point de vue pour une position universelle, je vous renvoie à mon article sur les cultures nationales à l’assaut des musées universels. Pour rappel, en décembre 2002, 18 directeurs de grands musées européens et américains ont signé une déclaration faisant de leurs musées « nationaux » des « musées universels ». Le souci de l’humanité dans son ensemble est ici le cache-sexe de l’inquiétude bien plus particulière au sujet des demandes de restitution d’œuvres d’art venant de cultures non occidentales.
Le hasard (mais est-ce un hasard finalement ?) fait que les indices de cet effort ne cessent de me poursuivre. Ainsi, j’ai sous les yeux le numéro de juillet-septembre de la revue de l’Association Française pour l’Information Scientifique (AFIS) dédiée à la science et aux pseudo-sciences. Un article de Jacques Van Rillaer (pp.94-97), professeur de psychologie, est consacré à l’universalisation par Freud de son complexe d’Œdipe (en 1951, le psychologue Robert Sears voyait dans cette prétention à l’universalité une “conception grotesque”). En voici les dernières lignes :
Freud a cru trouver dans un mythe un fondement pour l’universalité du complexe d’Œdipe. En fait, il a inventé un mythe qui s’est largement généralisé.
Revenons à L’Orientalisme : pour Edward Saïd, la campagne d’Égypte de Napoléon et la gigantesque Description de l’Égypte effectuée par les savants qu’il a embarqués avec lui et son armée ont été intégrées dans « une entreprise universelle » (p.102) permettant aux acteurs concernés de dénationaliser les événements pour leur donner une dimension touchant à l’humanité tout entière. Ce n’est pas pour ses propres intérêts, ou pour ceux de Napoléon, que la France est allée en Égypte mais pour éclairer le monde. On va donc déraciner l’événement de sa propre histoire pour en faire un récit conforme aux plus hautes aspirations.
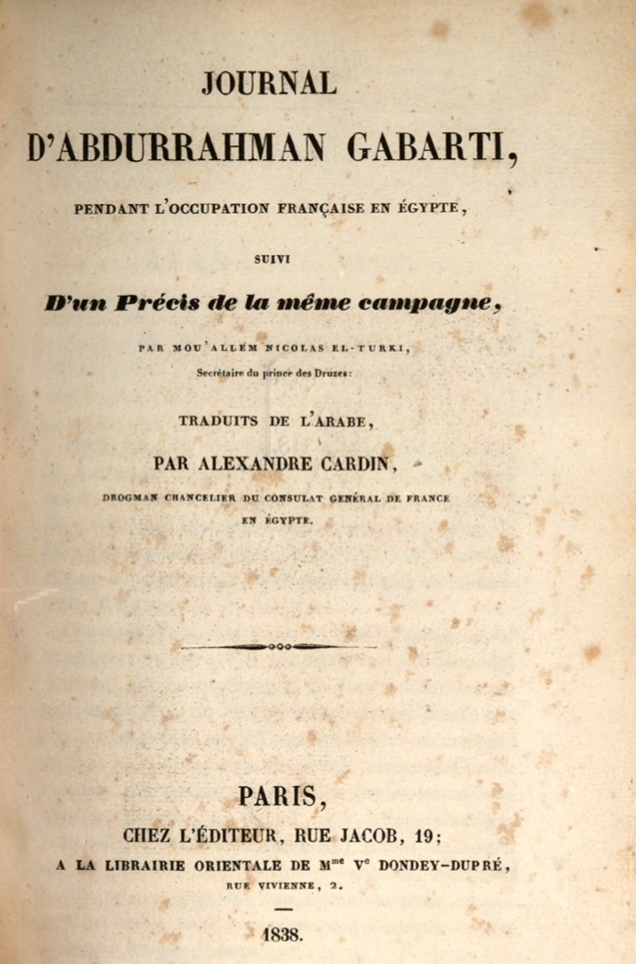 Le récit qui s’impose est évidemment celui du vainqueur. Le point de vue de l’autre (ici, les Égyptiens) est laminé par le rouleau-compresseur universalisant. Pourtant ce point de vue existe. Témoin des événements, le chroniqueur Abd al-Rahman al-Jabarti a raconté l’expédition napoléonienne dans son journal. En voici les premières lignes :
Le récit qui s’impose est évidemment celui du vainqueur. Le point de vue de l’autre (ici, les Égyptiens) est laminé par le rouleau-compresseur universalisant. Pourtant ce point de vue existe. Témoin des événements, le chroniqueur Abd al-Rahman al-Jabarti a raconté l’expédition napoléonienne dans son journal. En voici les premières lignes :
En 1213 de l’hégire (1798), commencèrent les guerres, les calamités, le bouleversement des affaires, les révolutions, enfin la ruine générale. (p.6 de l’édition de 1838, source ici)
Contrepoisons
Varier les points de vue, recueillir les expériences autres du même événement, diversifier les récits, explorer des devenirs historiques méconnus ou ignorés, comprendre des sensibilités, des perceptions, des imaginaires différents, entrer dans le fonctionnement intrinsèque d’une pensée étrangère, mais aussi savoir rendre compréhensible son propre point de vue, expliciter sa manière de penser, trouver des leviers pour transmettre et interagir sur un plan commun, établir des passerelles et s’enrichir mutuellement : autant d’exigences pour entrer dans la complexité des relations multiculturelles. Voilà qui est facilement dit, mais difficile à réaliser.
Heureusement, les contrepoisons à la dévalorisation ou à l’élimination du monde de l’autre existent. Par rapport aux années 50 où Gombrich a publié son histoire de l’art, ils sont de plus en plus nombreux, et en provenance de tous les champs de savoir. Je me limiterai ici à trois références.
D’abord, je renvoie à la passionnante conférence TED de la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie : Le danger du récit unique (vidéo ci-dessous). Elle date de 2009, et pourtant l’urgence est encore plus grande de l’écouter, dans un monde où les récits sur les autres deviennent de plus en plus réduits et réducteurs. Lutter contre les stéréotypes, c’est d’abord et avant tout diversifier les récits sur les autres, et ce en les écoutant. Quand les récits s’appauvrissent et s’uniformisent, la réalité suit le même mouvement. Voici quelques lignes de sa conférence :
Le poète palestinien Mourid Barghouti écrit que si l’on veut déposséder un peuple, la façon la plus simple de le faire est de raconter son histoire et de commencer par « ensuite ». Commencez l’histoire par les flèches des Amérindiens, et non par l’arrivée des Britanniques, et vous aurez une histoire totalement différente. Commencez l’histoire par l’échec de l’État africain, et non par la création coloniale de l’État africain, et vous obtiendrez une histoire totalement différente.
Ensuite, il y a une question essentielle que je ne ferai qu’effleurer ici mais dont il ne faut pas faire l’économie : nous voyons bien qu’il y a du différent et du semblable entre soi et les autres, mais qu’est-ce qui prime, la différence ou la similitude ? Quel doit être le point de départ ? Je reprendrai le point de vue de Jean-François Billeter dans son livre Contre François Jullien. Sans trop entrer dans le détail, il faut indiquer qu’il s’agit d’une polémique entre deux sinologues concernant une divergence essentielle dans l’approche de la pensée chinoise.
 Résumons en disant rapidement que Billeter reproche à Jullien de chercher systématiquement dans la pensée chinoise ce qui la différencie de la pensée grecque, et d’établir cette différence comme un impensé occidental. Billeter, quant à lui, part d’une communauté d’expérience entre Chinois et Occidentaux, d’où la possibilité de penser des échos, des résonances, des éclairages mutuels, entre philosophes chinois et occidentaux. Voilà qui l’amène à exprimer un point de vue qui me semble devoir être le socle de l’approche interculturelle :
Résumons en disant rapidement que Billeter reproche à Jullien de chercher systématiquement dans la pensée chinoise ce qui la différencie de la pensée grecque, et d’établir cette différence comme un impensé occidental. Billeter, quant à lui, part d’une communauté d’expérience entre Chinois et Occidentaux, d’où la possibilité de penser des échos, des résonances, des éclairages mutuels, entre philosophes chinois et occidentaux. Voilà qui l’amène à exprimer un point de vue qui me semble devoir être le socle de l’approche interculturelle :
Lorsqu’on pose a priori la différence, on perd de vue le fond commun. Quand on part du fond commun, les différences apparaissent d’elles-mêmes. (p.82)
Ces différences ne sont pas forcément celles qui correspondent à ce que je ne suis pas (mon envers, dans un effet-miroir). Elles peuvent être autres, sans refléter ce que je suis et qui reste impensé pour moi. Or, la position de Jullien risque de le faire passer non seulement à côté de la communauté de pensée, mais aussi de différences qui n’entrent pas dans le cadre de son interrogation. Voilà qui rejoint la question que pose l’anthropologue Jack Goody dans Le Vol de l’histoire :
Peut-on se satisfaire de sélectionner un ensemble particulier de facteurs culturels tout en négligeant ceux qui semblent aller dans le sens contraire ? (p.83)
 Enfin, je terminerai cette exploration avec l’approche de Bertrand Badie, politologue et spécialistes des relations internationales, qui me semble capitale ici. Dans son livre Pour une approche subjective des relations internationales, le lecteur comprend que ce dont il est question ici (redonner de la valeur au monde de l’autre), ce n’est pas anecdotique (du type : « voilà comment il faut donner sa carte de visite au Japon » ou « les Français se réunissent plus souvent et longtemps que les Néerlandais »). Il y va de la place de chacun dans le monde, de l’individu aux États :
Enfin, je terminerai cette exploration avec l’approche de Bertrand Badie, politologue et spécialistes des relations internationales, qui me semble capitale ici. Dans son livre Pour une approche subjective des relations internationales, le lecteur comprend que ce dont il est question ici (redonner de la valeur au monde de l’autre), ce n’est pas anecdotique (du type : « voilà comment il faut donner sa carte de visite au Japon » ou « les Français se réunissent plus souvent et longtemps que les Néerlandais »). Il y va de la place de chacun dans le monde, de l’individu aux États :
Agir sur la scène internationale impose désormais de comprendre en profondeur ce qu’est l’« Autre », la manière dont il voit le monde et se voit lui-même, ce qui le motive, ce qui l’anime, ce qui le choque ou le rassure, ce qui a fait l’histoire, les souffrances et les attentes qui lui sont propres. Autant de précautions, secondaires ou négligées hier, essentielles aujourd’hui. Les relations internationales sont devenues une incroyable bataille de sens que le monde européen, élargi à la notion d’Occident, a le plus grand mal à livrer, tant il était habitué à être « seul au monde », à bâtir ses relations et ses conflits sur la ressemblance entre rivaux plus que sur l’altérité vraie. (pp. 16-17)
Dans une conférence qu’il a donnée à l’ACTISCE le 3 mai 2024 et intitulée L’Europe n’est pas seule au monde (voir vidéo ci-dessous), Bertrand Badie précise dans sa conclusion les conditions de cette rencontre avec « l’altérité vraie » :
Faisons l’effort de nous poser trois questions. […] La première question, c’est : comment l’autre pense ? Comment il voit le même événement que nous avons tous les deux communément à subir ? […] Comment l’autre voit ? Deuxième question : comment l’autre voit la manière dont je vois ? Comment il me voit ? Comment il me perçoit ? Et troisième question, comment imagine-t-il que je le vois ?
Et si on arrive à démêler ces trois questions, on entrera dans le temps nouveau de la négociation. Puisque la négociation ne peut plus être transactionnelle (la négociation transactionnelle, c’est entre compères qui parlent le même langage). Elle ne peut être que globale, et elle ne peut être globale que si j’ai la modestie d’entrer les paramètres qui sont ceux de mes partenaires. […]
Et Bertrand Badie ajoute ensuite cette invitation qui devrait être le mot d’ordre universel (osons ici ce qualificatif !) de la relation avec l’autre, le plus lointain comme le plus proche :
Ne supportons pas le doigt qui est pointé sur l’autre et qui définit à l’avance la manière dont il doit penser et dont il doit percevoir le monde.
***
- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?
- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?
- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.
Quelques suggestions de lecture:
- L’interculturel à travers l’histoire : 5 articles à lire à la plage ou… au bureau
- Le paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence culturelle – entretien pour le Centre Algérien de Diplomatie Economique
- 4 exemples d’exotisme linguistique (petites laideurs et grosses erreurs)
- Quand le temps joue contre la montre (malentendu interculturel au Liban)
- Point d’étape et coup d’envoi !
- Le retour des cerveaux, nouveau symptôme de la désoccidentalisation du monde



Derniers commentaires