Le café des Japonais
 Le titre de cette note mérite quelques éclaircissements. Je lisais avec grand intérêt Dans les eaux profondes d’Akira Mizubayashi que les éditions Arléa viennent tout juste de publier. Ce livre explore le bain japonais à travers les souvenirs de jeunesse de l’auteur, des références cinématographiques, des digressions sur l’actualité et la politique du Japon, et un regard résolument interculturel au sens où Mizubayashi, Japonais de naissance, a la particularité d’avoir écrit son récit directement en français. Lui-même se sent pris entre la culture japonaise et la culture française, plus tout à fait de l’une, pas complètement de l’autre.
Le titre de cette note mérite quelques éclaircissements. Je lisais avec grand intérêt Dans les eaux profondes d’Akira Mizubayashi que les éditions Arléa viennent tout juste de publier. Ce livre explore le bain japonais à travers les souvenirs de jeunesse de l’auteur, des références cinématographiques, des digressions sur l’actualité et la politique du Japon, et un regard résolument interculturel au sens où Mizubayashi, Japonais de naissance, a la particularité d’avoir écrit son récit directement en français. Lui-même se sent pris entre la culture japonaise et la culture française, plus tout à fait de l’une, pas complètement de l’autre.
On apprend ainsi que le bain japonais n’est pas un lieu solitaire mais une pratique sociale, un moment privilégié où, de la salle de bains privée au bain public, se renforcent les liens entre individus, qu’il s’agisse de relations intergénérationnelles entre enfants et parents ou grands-parents, amicales, de voisinage, ou même entre inconnus. On se lave réciproquement le dos, on se masse, on se rince, on prend plaisir à la chaleur de l’eau, au délassement du corps, mais pas seul, avec l’autre.
Nulle ambiguïté incestueuse, nulle connotation graveleuse, nulle impudeur, nul malaise. Plutôt une érotisation discrète, sans vulgarité, comme lorsque l’auteur raconte avoir observé enfant l’étrange couleur foncée du téton d’une femme, ou qu’il se souvient avec émotion d’un bain pris adulte avec son épouse française, prélude à l’amour – sorte de préliminaire des préliminaires.
Le bain public (sentô) est aussi un lieu où l’on se parle, où des choses banales s’échangent, où chacun exprime le plaisir de l’eau, intensifiant ainsi par les mots ce que le corps ressent, mais aussi où des choses habituellement tues se disent, où des confessions sont possibles, où les cœurs peuvent s’épancher. Avec les vêtements, le masque est tombé, et le bain dans l’eau très chaude s’apparente pour les Japonais à la prise d’alcool, procurant à chacun une sorte d’ivresse sobre, seul moyen de délaisser le paraître pour se conformer à l’être.
Le sentô permet ainsi une ouverture à l’autre, presque interdite dans l’espace du dehors marqué par des conventions extrêmement rigides qui brident la liberté de parole (notons au passage qu’il faudrait dire “permettait” tant l’auteur lui-même constate que le Japon a évolué vers une pratique individualiste, moins sociale et plus hygiéniste, de la salle de bains, tout comme du bain public). Akira Mizubayashi lui trouve un équivalent occidental qui donne une idée de cette dimension essentielle. Ainsi, si l’on fait l’histoire de l’espace public japonais :
« il ne faudra pas oublier le sentô qui a joué peut-être un rôle semblable à celui du café dans le monde occidental » (p.29) car c’est « une sorte de confessionnal profane où s’échangent des paroles sincères » (p.76)

Sortons du bain, entrons dans l’ombre
Je lisais donc ce livre quand je me suis souvenu qu’aujourd’hui c’était le septième anniversaire de la catastrophe de Fukushima. J’ai consacré quelques articles à ce sujet (malheureusement) très intéressant :
- Les Japonais ont peur, les Français paniquent
- Le fax de Fukushima
- Fukushima, la culture et la responsabilité
- Culture des catastrophes, culture des risques
Or, il se trouve qu’Akira Mizubayashi évoque cette catastrophe dans son livre et il fait plusieurs digressions extrêmement utiles pour saisir certains ressorts culturels qui posent question en matière de gestion des risques au Japon. Une précaution s’impose ici : il ne s’agit pas de mettre la culture japonaise en accusation mais d’identifier certains points faibles qu’il faut savoir prendre en compte dans les organisations où une haute fiabilité est exigée. « Point faible » ne signifie pas non plus un « défaut » culturel mais une particularité qui ne doit pas être ignorée pour assurer la sécurité d’une organisation (l’analyse de ces points faibles pourrait, et devrait, être conduite ailleurs, par exemple dans l’environnement français : voyez ainsi Les Français ont-ils une relation contextuelle aux règles ? Exploration culturelle à partir du cas de l’accident d’Eckwersheim).
Voici le nœud qui dans son livre regroupe les enjeux qui m’intéressent ici :
« Il n’y a, au Japon, ni individu ni peuple, ni, à plus forte raison, citoyen au sens qu’on accorde à ces termes dans la philosophie politique. » (p.62)
Une telle affirmation peut sembler étrange, voire insensée. Mais l’argumentation est la suivante :
1) La logique ethnique du lien par le sang et de la fondation mythique du Japon prédominent encore aujourd’hui dans les consciences et dans la politique : d’où l’idée que le peuple a toujours été déjà là, en même temps que le pays, et que par conséquent il n’a pas à se former en tant que tel (en passant par exemple par un contrat social ou bien en affirmant une souveraineté que le pouvoir politique serait chargé de représenter). Dit autrement, il n’a pas à faire effort pour être peuple.

2) Partant de là, le Japonais se pense “seulement” comme Japonais, et non pas comme la réunion de deux identités, l’individuelle et la citoyenne. Il en est garanti par le lien du sang. Comme l’ordre des choses a toujours été déjà là, il n’a pas à être repris (au sens où l’on reprend quelqu’un qui a dit ou commis une erreur), il n’a pas être contesté, il n’a qu’à être suivi. La protestation est un scandale plus important qu’une politique scandaleuse :
« D’où le risque permanent de dérives droitières, fascisantes, dictatoriales auxquelles la multitude a tendance à se soumettre sans mot dire et presque de son propre gré. » (p.62)
Je ne commenterai pas une affirmation aussi lourde, mais ce qui m’intéresse ici, c’est l’une des conséquences de cette particularité historico-culturelle : « l’indifférence fondamentale des Japonais à l’égard des affaires de la Cité » (p.124)
3) Or, la catastrophe de Fukushima se distingue d’un tremblement de terre ou d’un « simple » tsunami : elle n’est pas uniquement liée à un phénomène naturel, elle n’est pas non plus l’affaire seulement d’une entreprise, mais elle renvoie à des choix de société, elle interpelle sur des enjeux politiques, elle met en péril une partie du territoire, elle touche une vaste population. Elle est cet événement typique qui devrait mobiliser le peuple japonais, tout comme les attentats de 2015 en France ont mobilisé les Français, ainsi que le rappelle l’auteur en faisant ce parallèle (pp.144-145).
Mais il n’en a rien été – ou très peu. Il y a bien eu des mouvements de protestation, quelques manifestations, mais aucun phénomène de vaste ampleur mobilisant les consciences des citoyens, initiant un grand débat public, lançant une vague de changements nécessaires pour prévenir d’autres catastrophes :
« Une force obscure, mais réelle et immense empêche les gens d’ouvrir un espace public où tout un chacun, sans crainte ni réserve, serait incité à se positionner, à affirmer ses pensées, à laisser libre cours à ses épanchement. » (p.144)
Fukushima, toujours
En juin 2012, Akira Mizubayashi était interviewé par L’Orient Littéraire. Il décrivait cet entre-deux culturel dans lequel il baignait déjà depuis de nombreuses années, qui lui permettait de mettre en regard la culture japonaise et la culture française. De ce point de vue particulier, il apercevait ce que j’appelle les points faibles de chacune des cultures :
« La culture japonaise est codifiée à l’extrême. L’individu y disparaît au profit du groupe. Le point de départ, c’est la communauté ; c’est elle qui détermine la place occupée par le sujet. Et c’est le détour par la langue et la culture françaises, et surtout ma rencontre avec les écrivains des Lumières qui m’en ont fait prendre conscience. »
« Ce qui m’horrifie en France, c’est le caractère conflictuel des relations. Quand l’individualité s’affirme, les individus rentrent plus facilement dans des relations conflictuelles. À l’école japonaise, on dispense des cours de civisme et de morale, on enseigne aux enfants comment ne pas déranger les autres, on leur transmet ce souci de rester en paix. Alors qu’en France, l’agressivité latente est toujours perceptible et elle peut émerger dans n’importe quelle situation, un bus bondé par exemple. »
Ainsi, selon Akira Mizubayashi, la communauté prime tellement sur l’individu au Japon qu’il n’y a que deux stratégies pour gérer les opinions minoritaires : la persuasion (faire en sorte que la minorité délaisse son point de vue discordant) ou l’exclusion (la mise à l’écart de la minorité par l’indifférence ou la coercition). C’est que le consensus est la valeur sociale qui prime avant tout. Celui-ci ne peut être ébranlé par une minorité, et encore moins par le débat public, mais par un événement dont la violence doit avoir une intensité hors du commun pour produire un effet sur cette puissante force d’inertie :
« Au Japon, on cherche à tendre vers la cohésion parfaite, on sacralise le consensus au point que la communauté n’est amenée à changer d’avis que si elle est confrontée à une catastrophe. C’est ce qui s’est passé avec le désastre de la bombe atomique ; et c’est ce qui s’est produit à Fukushima. La catastrophe seule a permis que le consensus soit remis en cause, que soit contesté le mythe de la sécurité absolue des centrales nucléaires. »
Mais nous ne sommes alors qu’en 2012. La catastrophe de Fukushima avait eu lieu l’année précédente seulement. Dans son livre paru la semaine dernière, il apparaît que cette remise en cause n’a pas eu l’effet escompté : la faille de citoyenneté s’est à présent quasiment refermée. Un coup d’épée dans l’eau, en quelque sorte.
Le risque de la folie pure
 Pour aller plus loin et en tirer des enseignements non seulement pour les Japonais mais aussi les Français, je vais me référer à un passage du livre d’Edward T. Hall, Au-delà de la culture, qui m’a fortement marqué quand je l’ai lu la première fois. Il commence ainsi (p.126 de l’édition en Points Essais) :
Pour aller plus loin et en tirer des enseignements non seulement pour les Japonais mais aussi les Français, je vais me référer à un passage du livre d’Edward T. Hall, Au-delà de la culture, qui m’a fortement marqué quand je l’ai lu la première fois. Il commence ainsi (p.126 de l’édition en Points Essais) :
« Il est plus facile de prévoir les désordres et les conflits en gestation dans les cultures à contexte faible que dans les cultures à contexte riche. »
Je ne développerai pas ces notions de contexte faible et de contexte riche (voyez ici). Je rappellerai seulement que dans un contexte faible on a tendance à avoir une communication directe et explicite (on dit ce qui est) et dans un contexte fort une communication indirecte et implicite (on suggère ce qui est). La culture japonaise est considérée comme à très fort contexte, la culture américaine comme à faible contexte, et la française, disons, entre les deux. Hall poursuit ainsi :
« Dans les premières, les liens sociaux disparaissent ou se relâchent en cas d’échec. »
Ici, la traduction en français de cette phrase laisse à désirer. Voici ma traduction : « Les liens qui lient les gens sont quelque peu fragiles, alors les gens s’éloignent ou laissent tomber si les choses tournent mal » [the bonds that tie people together are somewhat fragile, so that people move away or withdraw if things are not going well].
A contexte faible, les liens entre les personnes ne les obligent pas entre elles en permanence dans un sentiment de mutuelle solidarité. En situation de crise, on peut avoir deux types d’attitudes révélatrices de cette état de fait : le fuyard qui abandonne son poste et ses collègues pour littéralement sauver sa peau, et le lanceur d’alerte qui n’hésitera pas à signaler un problème, quitte à mettre en péril l’harmonie de sa relation avec ses collègues ou sa situation personnelle, voire familiale. En revanche :
« Selon l’anthropologue Francis Hsu, et d’autres, dans une société à contexte riche les liens sociaux sont si forts qu’on a tendance à laisser une immense souplesse au système. »
Là où, comme au Japon, les liens sociaux ont une valeur quasi sacrée, leur préservation prime sur le reste, quitte à mettre en péril une organisation défaillante. On aura ainsi plus tendance à privilégier l’harmonie de la relation avec un collègue plutôt que de signaler une erreur, ce qui peut pourtant mener à la catastrophe. Sans aller jusque-là, la réticence à licencier est symptomatique de ce phénomène : essayons de perfectionner le système plutôt que faire perdre la face aux hommes. La suite du texte est capitale :
« Avant l’explosion, il n’y aura vraisemblablement personne pour tirer la sonnette d’alarme. Lorsque les limites sont dépassées, il faut les franchir si énergiquement qu’il est impossible de revenir en arrière. »
C’est là que nous retrouvons Akira Mizubayashi. Plus une culture est à contexte élevé, moins on aura tendance à exprimer le négatif, à débattre de ce qui fonctionne mal, à encourager les opinions minoritaires et à proposer des alternatives : seule la catastrophe forcera le changement car personne n’aura tiré le signal d’alarme. Le problème pour nous Français, c’est que nous avons affaire à un contexte assez faible pour ne pas craindre la conflictualité des opinions mais assez fort pour ne pas oser réformer ce qui devait l’être avant le désastre. Quant aux Japonais, la compréhension de leur culture est essentielle pour qui développe des projets avec eux, car :
« C’est de la folie pure de vouloir lier son sort à des civilisations riches en contexte, à moins d’être sérieusement informé de celui-ci. »
A condition que les Japonais eux-mêmes soient sérieusement informés de leur propre culture en ce qui concerne ses zones d’ombre, cette « force obscure » si bien décrite par Akira Mizubayashi. Mais nous, Français, sommes-nous également bien conscients de notre propre force obscure ? Telle est une des questions qu’on se pose en lisant son livre passionnant.
* * *
- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?
- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?
- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.
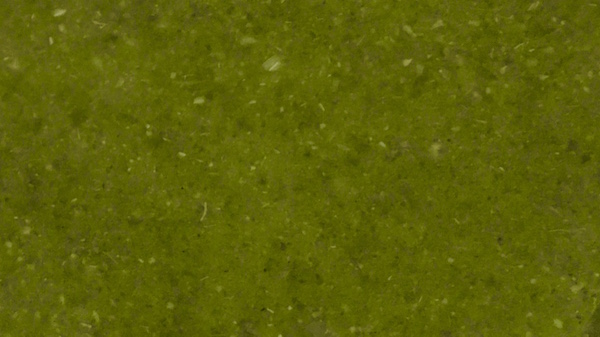


Merci pour cet article qui me fait découvrir Akira Mizubayashi.