Illustrer ou explorer ?
Entrons dans le vif du sujet : l’étude de cas vient trop souvent illustrer des concepts théoriques. La recherche de légitimité académique (ou le désir de paraître académique) entraîne de nombreux ouvrages et praticiens dans ce travers. Pourquoi un « travers » ? Parce que le cas choisi l’est en fonction de sa conformité au modèle théorique préalablement exposé. Par conséquent, d’autres situations auront été écartées parce que n’entrant pas dans le cadre défini, soit qu’elles restent en deçà de ses limites, soit qu’elles les dépassent. Or, la vie excède la situation conforme à la théorie, elle est justement constituée des « autres » situations.
Lors d’une session de formation, l’intervenant peut alors avoir tendance à rechercher des réponses « correctes » à ses questions, autrement dit celles qui correspondent aux présupposés conceptuels qu’il a transmis (ou croit avoir transmis). Les réponses qui ne leur correspondent pas seront « incorrectes ». On se retrouve là dans la relation traditionnelle du sachant et de l’ignorant, où ce dernier doit progresser en direction du premier pour devenir, faire, penser comme lui. Bien que bienveillant, le sachant reste directif. Or, forme-t-on une personne pour qu’elle devienne comme soi ou pour qu’elle développe ce qu’elle peut être ?
Au lieu d’exposer des concepts théoriques (dans un premier temps) pour les illustrer par une étude de cas (dans un deuxième temps), il faudrait plutôt proposer une étude de cas (dans un premier temps) pour en tirer collectivement des concepts théoriques (dans un deuxième temps). L’une des différences majeures entre les deux approches tient au fait que la dernière laisse une place à la surprise (le concept inattendu que les participants mentionnent et que le formateur n’avait pas prévu d’aborder, le libre débat sur un problème analogue ou proche, le partage d’une anecdote que le cas permet de se remémorer et qui de ce fait s’en trouve enrichi par l’expérience vécue…) et à une activité et une interactivité bien plus grandes de la part des participants.
Coup d’œil dans le rétroviseur
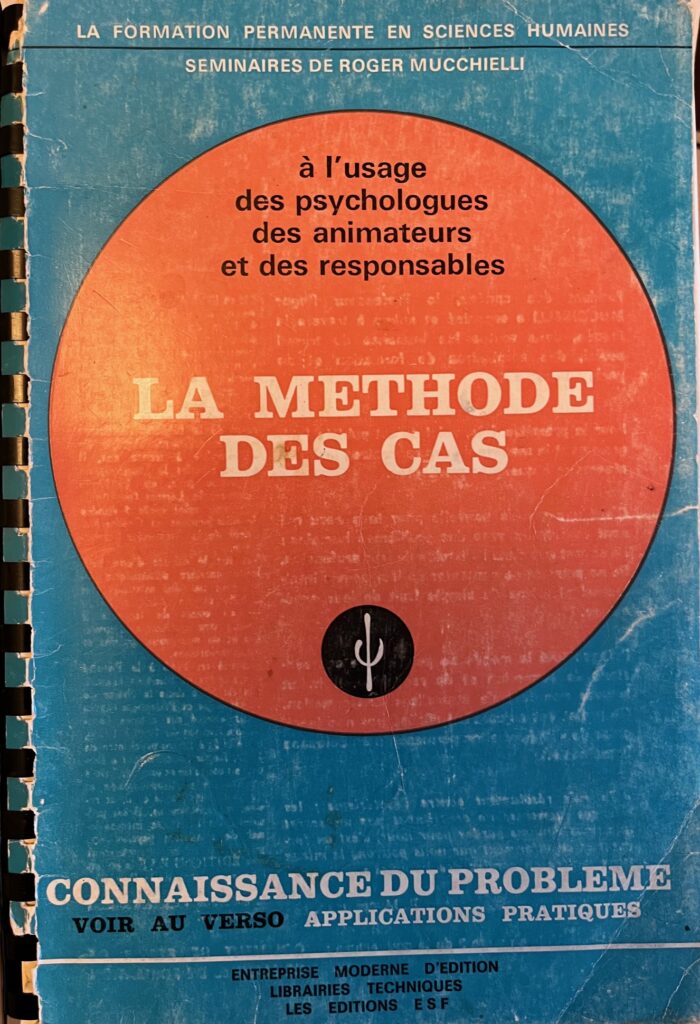 Les remarques précédentes, un peu rapidement et sèchement assénées, je me les faisais tout en lisant une brochure d’autoformation rédigée par le spécialiste en psychologie et pédagogie Roger Mucchielli (1919-1981). L’ouvrage est consacré à la méthode de cas et il a été publié il y a plus d’un demi-siècle. La méthode en question a, elle, plus d’un siècle… À l’origine, ce sont des professeurs de droit de Harvard qui ont commencé à faire cours en immergeant les étudiants dans des cas réels pour qu’ils en tirent les concepts clés. Les écoles de commerce ont repris et développé cette approche, aujourd’hui banalisée, si bien qu’elle est devenue un marché avec des centres de ressources où vous pouvez acheter des études de cas (voir par exemple The Case Centre).
Les remarques précédentes, un peu rapidement et sèchement assénées, je me les faisais tout en lisant une brochure d’autoformation rédigée par le spécialiste en psychologie et pédagogie Roger Mucchielli (1919-1981). L’ouvrage est consacré à la méthode de cas et il a été publié il y a plus d’un demi-siècle. La méthode en question a, elle, plus d’un siècle… À l’origine, ce sont des professeurs de droit de Harvard qui ont commencé à faire cours en immergeant les étudiants dans des cas réels pour qu’ils en tirent les concepts clés. Les écoles de commerce ont repris et développé cette approche, aujourd’hui banalisée, si bien qu’elle est devenue un marché avec des centres de ressources où vous pouvez acheter des études de cas (voir par exemple The Case Centre).
Pour Mucchielli, la méthode des cas est inadéquate pour acquérir de l’érudition pure (ex. connaissances historiques) ou un savoir-faire technique (ex. jouer d’un instrument). En revanche, elle est la plus efficace pour développer ce qu’il appelle « l’intelligence de la situation » (p.6). C’est l’expérience acquise qui permet de développer la compréhension des structures qui organisent le donné :
Par un paradoxe plus apparent que vrai, la meilleure conceptualisation, chez le chevronné, s’accompagne d’une meilleure compréhension du problème actuel dans son actualité même, sa singularité, ses caractéristiques concrètes particulières. (Mucchielli, p.8)
Cela ne signifie pas non plus que la personne « chevronnée », « formée sur le tas », serait la plus apte à comprendre le sens de l’expérience. Il s’agit plutôt de s’immerger dans le réel pour le soulever et décrire ce qui le structure, ce qui suppose des outils et un accompagnement. Mucchielli définit ainsi la méthode des cas comme l’étude de « situations-problèmes concrètes présentées avec leurs détails réels » afin de provoquer une prise de conscience de la situation, puis une conceptualisation et une recherche de solutions efficaces (p.10).
Mucchielli ajoute ensuite :
En effet, c’est plutôt le débutant qui, pour comprendre un cas et le traiter, fait appel à une théorie générale ou à des principes a priori.
Voilà qui se vérifie en permanence avec ces nombreux messages d’étudiants à qui on demande de rédiger un mémoire sur le management interculturel. J’ai déjà évoqué ce sujet ici Aux étudiants en panne d’idées pour leur mémoire en management interculturel. Il est facile de deviner le plan de ces mémoires. Première partie : Les théories du management interculturel, deuxième partie : Mise en pratique.
Pourquoi ? Parce que c’est ainsi que se conçoit le travail académique. Problème : le management interculturel s’inscrit dans des situations singulières, dans l’expérience concrète, dans le vécu. D’où la difficulté pour trouver des cas pratiques qui illustrent les théories précédemment exposées, et ensuite l’ennui non seulement à rédiger ces mémoires, mais aussi à les lire, car la réalité ne cadre jamais tout à faire avec la théorie, sauf à la distordre, à la raboter ou à l’amplifier fictivement.
Pour ne plus marcher sur la tête
Revenons à Mucchielli. Avant de lire les lignes ci-dessous, rappelons qu’elles ont plus d’un demi-siècle et que si vos positions et pratiques en ce qui concerne l’enseignement et la formation au management interculturel restent attachées à la relation descendante d’un sachant vers un ignorant, il y a peut-être un léger souci d’efficacité :
Étant données les exigences d’une information des esprits qui doit de toute nécessité se compléter par une formation des personnes en vue d’une action sociale ajustée, on peut se demander s’il ne conviendrait pas, en procédant à l’inverse de la conception universitaire classique, de partir des situations concrètes en y impliquant personnellement l’étudiant d’une manière telle, que la résolution de la situation le lance à la fois vers la recherche active de l’information nécessaire et vers l’expérience de la décision ajustée. (p.14)
Procéder à l’inverse de la conception universitaire classique. Attention, ce n’est pas ici faire de l’anti-académisme primaire puisque, comme nous l’avons indiqué, il y a des cas où cette conception reste légitime. Mais il y en a aussi de très nombreux autres où elle ne fonctionne pas car elle génère ce que Mucchielli appelle « des récepteurs amorphes », passifs donc.
Procéder à l’inverse de la conception universitaire classique, c’est donc immerger les étudiants ou les stagiaires dans des études de cas et les faire travailler dessus comme si nous étions dans le monde professionnel réel. Il y a une forte dimension de jeu de rôle dans le principe. En ce qui me concerne, quand il s’agit d’étudiants, soit je crée des études de cas à partir de matériaux réels (ex. un rapport d’activité de l’Agence Française de Développement mentionne les difficultés culturelles rencontrées au Burkina Faso lors d’un projet de développement de transport urbain), soit je leur demande de mener des entretiens avec des acteurs de l’international pour recueillir des cas sur lesquels ils vont ensuite travailler (voir des exemples ici, là et là).
Si on voulait faire ici une référence un peu pédante (qui est en fait un petit plaisir égoïste car elle me rappelle mes lointains cours de philosophie quand pour préparer le concours de Normale Sup’ nous étudiions l’Idéologie allemande de Karl Marx, que nous avions au programme avec, curieux compagnonnage, le livre XI des Confessions de Saint Augustin), on pourrait dire que nous sommes ici un peu comme Marx reprochant à Hegel sa dialectique idéaliste (l’histoire, c’est le développement de l’Idée), à laquelle il voulait substituer une dialectique matérialiste (l’histoire, c’est l’évolution des conditions matérielles et des faits pratiques) :
Pour moi, le mouvement de la pensée n’est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l’homme. […] Chez lui elle marche sur la tête ; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable. (postface au Capital, Folio, p.107)
Une affaire de points de vue
Ma dernière note sur ce blog abordait déjà cet enjeu (voir Que vaut le monde des autres ?) Ici, le fait de passer par une étude de cas oblige à saisir le point de vue des protagonistes du cas étudié. Dans une situation interculturelle, on ne peut pas en faire l’impasse. Au lieu d’exposer des généralités dangereuses (car génératrices de stéréotypes) sur les cultures, on a tout à gagner à faire travailler sur les réactions, perceptions et représentations des acteurs étrangers de la situation en question tout en réfrénant la tendance à généraliser les enseignements qu’on peut tirer de celle-ci. Si des concepts clés peuvent être mis en évidence pour structurer la situation, cela ne signifie pas non plus qu’ils s’appliquent à toute autre situation analogue.
Cette sensibilité aux points de vue est facilitée par l’organisation du travail : « Pas de méthode des cas sans travail en groupe », rappelle Mucchielli (p.33). Seul, on reste prisonnier de ses propres conceptions et préjugés. Pour en sortir ou les mettre à distance, pour produire cet écart utile par rapport à soi-même, il est nécessaire de se confronter à d’autres points de vue, si possible hétérogènes. Deux juristes auront certainement des analyses enrichies par rapport à un seul juriste, mais un juriste et un commercial confronteront et complèteront leurs approches pour apporter des réponses inattendues. L’homogénéité est en effet dangereuse :
Un groupe homogène (par exemple des professionnels de la même entreprise, du même rang et de la même génération ou des Assistantes sociales d’un genre de Service…) est, à son insu, prisonnier de stéréotypes, c’est-à-dire qu’il aura tendance à attribuer une valeur d’objectivité à ce qui réalisera l’accord commun du groupe, alors que cet accord se fait automatiquement et implicitement sur les idées et valeurs qui sont collectivement admises (non-mises en question) dans le groupe. (Mucchielli, p.34)
Ces dernières lignes sont remarquables de clarté. Si toute formation professionnelle doit évacuer ce risque, c’est encore plus le cas dans la formation en management interculturel, où l’intervention de protagonistes de différents pays expose en permanence au danger des stéréotypes nationaux. Face à cela, il faut produire « la rencontre forcée de l’opinion des autres » (p.70). Dans les formations interculturelles, cela passe par la constitution de groupes de 4 à 5 participants de différentes nationalités. Si l’on a affaire à un seul groupe national, il est encore plus impératif, pour forcer cette rencontre, de partager des témoignages singuliers et des cas venant de partenaires étrangers.
Finalement, la matière première sur laquelle le formateur va travailler, c’est la perception de la réalité. Il s’agit d’entrer dans la variété des points de vue afin de comprendre leur mode de fonctionnement et d’identifier comment agir lors des interactions :
Un des buts pédagogiques de la méthode des cas est justement la compréhension de la situation telle qu’elle existe pour les protagonistes du drame, c’est-à-dire non pas telle que nous la percevons, mais telle qu’ils la vivent, avec les significations qu’elle a pour eux. (Mucchielli, p.71)
En effet, le nœud du problème est clairement mis en évidence par Mucchielli :
Chacun de nous, en croyant réagir à la Réalité, ne réagit en fait qu’à la réalité-telle-qu’il-la-perçoit. (p.71)
Cette phrase, écrite il y a plus d’un demi-siècle par un expert de la formation professionnelle, chacun devrait la porter en soi au quotidien, à chaque instant, en toute conscience, pour en faire une sorte de rappel à l’ordre quand on estime que son opinion est forcément la meilleure ou qu’on s’apprête à juger des autres, de ce qu’ils sont, font ou pensent.
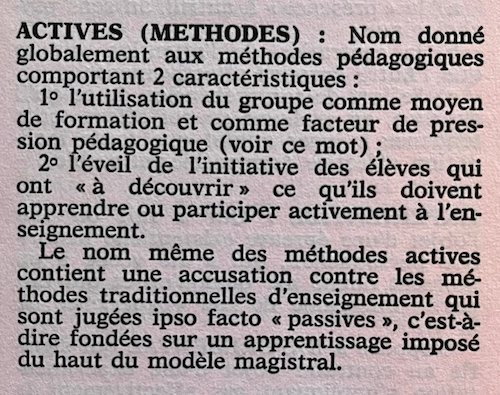
***
- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?
- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?
- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.
Quelques suggestions de lecture:
- Le retour des cerveaux, nouveau symptôme de la désoccidentalisation du monde
- Aux frontières du réel (quand une carte met en péril une négociation)
- 4 exemples d’exotisme linguistique (petites laideurs et grosses erreurs)
- Le paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence culturelle – entretien pour le Centre Algérien de Diplomatie Economique
- Mattel et les défis de l’influence: le casse-tête chinois de Barbie
- Gestion des Risques Interculturels – 6 articles de 2013



Derniers commentaires