En conclusion provisoire de cette série d’articles consacrés à ce pays très méconnu qu’est l’Arabie saoudite (voir 1, 2, 3 et 4), je vous propose quelques passages de mon roman A travers sables paru en mars dernier aux éditions de l’Olivier. Les photos de cet article ont été prises lors de différents séjours en Arabie saoudite.
Les extraits qui suivent proviennent du premier chapitre intitulé Le Royaume. Le narrateur vient d’atterrir à Djedda, au bord de la mer Rouge. Il est chargé par un grand groupe français d’évaluer des projets d’investissement hôtelier en Arabie saoudite. Il découvre un monde complexe où il n’y a pas de nuances mais seulement des extrêmes…
***
En sortant de l’avion, une bouffée de chaleur humide imprègne immédiatement les vêtements. Puis, sans transition, l’air glacial de l’aéroport trop climatisé me saisit la gorge. J’ai le pressentiment qu’ici il n’y a pas de milieu ni de nuances, juste des extrêmes et des contraires. Mais je n’ai pas le temps de raisonner, je me trouve noyé dans une cohue indescriptible d’hommes et de femmes de tous pays et de toutes conditions, dont le vêtement tient lieu de passeport : double étoffe immaculée des pèlerins de Médine et La Mecque, chéchia et djellaba des Maghrébins, voile coloré orné de dentelle des Indonésiennes, chemise sur pantalon ample ou pagne long des Pakistanais et Afghans, turban des Tchadiens et Soudanais, sari des Indiennes, costume cravate des hommes d’affaires, abaya des Chrétiennes obligées de dissimuler leur indécence sous cette tenue noire, toute une bigarrure bruyante et compacte que la tunique blanche des Saoudiens et le voile noir intégral des Saoudiennes assaisonnent comme des grains de sel et de poivre. Agglutinés les uns aux autres avec l’air hagard de ceux qui viennent de quitter leur monde pour une autre planète, perdus dans cette réunion artificielle d’hommes dispersés, assourdis par la confusion des langues, on se regarde, furtivement certes, mais intensément. Regards suspicieux des policiers, regards impatients des pèlerins, regards vides des domestiques, regards méprisants des privilégiés, regards résignés des plus pauvres, regards fuyants des égarés, regards clandestins des femmes voilées, regards d’hommes trop différents pour se parler, regards d’exilés et de déracinés, d’enthousiastes et d’illuminés, de maîtres et d’esclaves. Il y a dans ces regards tant de conversations muettes que je pourrais les entendre malgré le brouhaha, mais le mouvement de la foule m’entraîne dehors et me pousse dans un taxi pakistanais qui se met à filer en trombe dans la chaleur étouffante tandis que j’ai encore à l’esprit l’image de la tasse de café prise le matin sur une terrasse parisienne dans la douce fraîcheur du mois de mai.
* * *
J’habite une petite villa aux murs de tôle, posée telle une boîte au milieu d’autres villas alignées dans un complexe à la géométrie militaire, trente sur trente villas, neuf cents boîtes toutes semblables encadrées par un mur haut de plusieurs mètres muni de barbelés et de miradors. Pour pénétrer dans le complexe, il faut franchir un double check point où derrière des sacs de sable des automitrailleuses pointent leur canon sur les voitures. A l’aéroport, on remplit une fiche où il est indiqué que la peine de mort s’applique pour le trafic de drogue. Ici on coupe les mains des voleurs et les pieds de ceux qui récidivent, ici on décapite au sabre et en place publique assassins, violeurs, trafiquants d’alcool ou de drogue, homosexuels – lesquels parfois, comme les femmes adultères, sont condamnés à la lapidation ou à sept mille coups de fouet. Ici arrivent par millions les travailleurs des pays les plus pauvres et par dizaines de milliers les cadres des pays les plus riches. L’esclavage à peine déguisé côtoie l’opulence la plus outrancière. Ici, il n’y a pas de cinéma, pas de théâtre, pas de concert, pas d’alcool, pas de discothèque, aucune distraction en dehors de l’espace privé. Ici, les hommes et les femmes vivent dans deux mondes hermétiques, un mur sépare dans les restaurants les familles des hommes célibataires, les femmes sont voilées de noir de la tête aux pieds, on leur interdit de conduire, on risque la prison si on se trouve avec une femme qui n’est pas la sienne, ne serait-ce que pour boire un thé ou la raccompagner chez elle. Ici, tous les jours se ressemblent, tous les jours se répètent, le climat varie à peine, l’été dure huit mois, avec des pointes à plus de cinquante degrés, et l’hiver il fait simplement moins chaud. Le ciel est uniformément bleu, mais d’un bleu sans profondeur, qui tire vers le gris ou le jaune selon que domine la pollution ou la poussière du désert. Et quand passe un nuage, on le regarde comme un étranger, on attend qu’il s’épuise.
* * *
Mon bureau se situe à l’intersection de deux axes majeurs au nord de la ville. Il n’a rien de majestueux, bien au contraire. Le Groupe hésite encore à investir dans ces lieux qui dévorent les hommes, et donc coûtent de l’argent. Le seul luxe consiste en un salon aux canapés élimés avec sur les murs des photos jaunies des plus beaux hôtels du Groupe. Mais comme la douane a envoyé à la broyeuse celles qui montraient des scènes de piscine, de bar ou de restaurant où apparaissaient une femme, un bout d’épaule de femme ou un verre d’alcool, il ne restait plus que les centres d’affaires et de séminaires pour illustrer la sensuelle devise du Groupe, Hôtels Icare, Plaisir du matin, Désir du soir. Je reçois dans ce réduit des investisseurs, des propriétaires, des promoteurs, des intermédiaires, tous plus ou moins princes, plus ou moins cheikhs, plus ou moins affiliés à une tribu toujours prestigieuse, à un clan toujours puissant, à une famille toujours riche, des types pour la plupart obèses qui, quoi qu’il arrive, demeurent en équilibre sur leur base arrondie. Des méfiants qui me regardent de haut et de loin, des confiants qui ne me lâchent pas la main, de petits émissaires qui prennent des airs de grands seigneurs, des dandys qui ont gardé l’accent suisse en fréquentant les meilleures écoles de Genève, des rustres qui se caressent le pied en rêvant de racheter la tour Eiffel, des fanatiques qui viennent renifler le Chrétien, des débauchés qui promettent des femmes et du vin, des farfelus qui se disent intimes du roi ou descendants du prophète, ou l’inverse. On boit un thé, on fume une cigarette, on échange des banalités comme partout, on parle du temps qu’il fait comme si ce n’était pas toujours le même, on reprend un thé, on rallume une cigarette. Puis ils évoquent leur projet, sortent des brochures, étalent des plans, s’étonnent de ne pas avoir encore signé de contrat alors qu’ils sont là depuis dix minutes à peine. J’ai devant moi des images apocalyptiques, une réplique de l’Arc de Triomphe en verre, un palais de Versailles avec des mosquées, un hôtel auprès duquel le Panthéon passerait pour un modeste cabanon, des tours délirantes en forme de spirale, de stalagmite, de décapsuleur, de champignon, de boîte de conserve, et même une ville entière qui, vue d’avion, ressemblera étrangement à la rose nord de Notre-Dame de Paris, son plus beau vitrail. Ils veulent tous leur hôtel cinq étoiles, voire leurs nombreux hôtels cinq étoiles ou des chaînes entières d’hôtels cinq étoiles, ils me prennent pour un distributeur d’étoiles, une sorte de Merlin l’Enchanteur sorti de Brocéliande pour semer des étoiles dans le désert. Qu’en pense le Groupe ? Que propose le Groupe ? Est-ce que le Groupe est prêt à s’engager ? Quand signe-t-on avec le Groupe ? Ils sont pressés, pensent ouvrir leurs hôtels dans les mois prochains et la déception se lit sur leur visage quand je leur réponds que je ne suis là que pour visiter leur terrain et faire un rapport. Et alors qu’ils reprennent un thé et une cigarette, les uns décontenancés, les autres furieux, j’imagine leurs projets sortis du sable, ces débauches d’architecture boursouflée, ces grandes cathédrales vides, ces milliers de chambres glaciales dans ce pays austère où il n’y a aucune distraction, et soudain tout devient abstrait, irréel, fantomatique, je ne sais quoi leur dire, je suis aussi démuni que si j’avais affaire à une délégation d’extraterrestres.
* * *
Deux rendez-vous aujourd’hui. Le matin, je me rends sur un chantier à l’invitation de l’heureux propriétaire d’une construction en forme de paquebot qui comprendra des magasins, des restaurants, une piscine et, évidemment, un hôtel cinq étoiles. Il m’assure que la chose se trouve dans une zone en plein développement et, pour preuve, me montre sur un plan les différentes rampes et bretelles d’autoroute qui bientôt encercleront le bateau en béton armé. Et puis, me précise-t-il fièrement, la proue est tournée vers la mer Rouge. Ah ? Il n’est pas tourné vers La Mecque ? dis-je négligemment sans mesurer la portée de mes paroles. Le propriétaire, rouge de honte ou de colère, murmure quelque chose dans sa barbe, s’enfonce dans sa voiture et disparaît. L’après-midi, un promoteur m’envoie son chauffeur pour aller visiter le site de la rosace urbaine de Notre-Dame qui pousse au milieu du désert à cent cinquante kilomètres de Djedda. La route se divise en routes secondaires qui seront les rues de la nouvelle ville, toutes parfaitement goudronnées, découpant le désert en lots réguliers pour les futures habitations. Mais le détail le plus surprenant consiste dans les centaines, les milliers de réverbères déjà installés, de telle sorte que, vue de loin, cette partie du désert ressemble à une vaste scène de théâtre où des hommes figés, tête baissée, seraient plantés là dans l’attente désespérée de se mettre en mouvement. Et moi-même, les pieds cloués au sol et le dos voûté par la chaleur, je reste pétrifié face à un tel spectacle. Le promoteur m’expose le projet, m’indique les emplacements et noms des bâtiments, l’université du roi Abdul Aziz, la caserne du roi Fayçal, l’hôpital du roi Fahd, l’avenue du roi Abdallah, et ainsi de suite. Mais il se fait tard, je me dirige vers la voiture. Attendez, attendez, s’écrie le promoteur, vous n’avez pas tout vu, attendez un instant. Et tandis que le soleil vient juste de se coucher, les réverbères, dans une sorte de suprême exaltation de l’inutile, s’allument en même temps, parsemant ainsi l’immense espace vide de halos isolés comme si les têtes baissées des hommes figés versaient des larmes de lumière sur leur existence désolée.
* * *
Le dedans et le dehors. La nouvelle route bitumée brille au soleil comme un miroir. Cette fois, après une dizaine de kilomètres, la voiture s’arrête devant un palais en construction. Comme je n’arrive pas à cacher mon embarras, l’architecte, tout à l’heure si fier – Vous allez voir ce que vous allez voir ! –, me regarde d’un air de dire : Que voulez-vous ? Je n’y suis pour rien, on me demande ça, je fais ça. Face à tel bâtiment, il me semble qu’on vient d’ouvrir le crâne d’un homme ivre de puissance et de grandeur pour couler ses fantasmes dans le béton. Derrière les échafaudages, je reconnais une façade versaillaise, des colonnades Empire, des arcades vénitiennes, tout un assemblage d’éléments si divers et si grandioses que j’ai du mal à faire la part entre ce que je vois et ce que j’imagine. J’entre dans le palais en chantier, désert en ce jeudi après-midi. Mes pas résonnent longuement dans le hall d’entrée dont le plafond se perd dans une voûte inaccessible au regard humain. Une coupole édifiée dans une lointaine atmosphère projette un puits de lumière sur des murs qui s’étirent sans fin, aussi hauts que larges. Assurément, il y a là de quoi loger un peuple de géants. L’escalier à double volée est posé, les murs sont déjà revêtus de marbre iranien et les colonnes ornées de feuilles de lierre sculptées. Comme chaque fois que je visite un chantier où les éléments finis côtoient les éléments bruts, les coffrages, les matériaux, les gravas, je suis assailli par un mélange de sensations troubles. Je perçois le bâtiment comme un être vivant en sursis, ni tout à fait né, ni tout à fait mort, un être intermédiaire et monstrueux englué entre le chaos et la création. Le gigantisme de la construction dégage paradoxalement une impression de fragilité, il semble qu’un rien pourrait en interrompre la gestation. Finalement, de quoi ce ventre immensément vide accouchera-t-il ? Alors qu’à l’extérieur je ne parvenais pas à rassembler mes idées, je dois maintenant faire face à ma propre précarité, comme si en pénétrant dans le palais je venais de rapetisser à la dimension d’un insecte ou d’un grain de poussière, comme si moi aussi je gisais dans la vie figé dans une forme inachevée et stérile. Laissant derrière moi ces murs de tragédie où le vide se traverse comme la mort dans un cimetière, je me retrouve avec soulagement dans une arrière-cour délimitée par un mur rehaussé de pots de fleurs cimentés. Avec l’espoir d’échapper à quelque chose qui me happe, je me hisse sur des gravas pour jeter un œil derrière. J’attends quelques instants que mes yeux s’habituent à la lumière, mais en vain : il n’y a rien, absolument rien, ni construction, ni arbre, ni plante, rien d’autre que le désert qui s’étale sur des milliers de kilomètres, le néant le plus total.
* * *
Malheur, ils sont tous habillés pareil ! Tunique blanche (thob), keffieh rouge et blanc (chmar) maintenu sur la tête par un cercle noir (igal). Comment les reconnaître ? Et comment distinguer une éminence d’un domestique ? Au milieu de cette nuée d’hommes en blanc, nous sommes deux à être habillés à l’occidentale, l’autre est un Libanais. Et pour corser la difficulté, chacun se présente par son prénom. Faites-vous des relations, ça marche comme ça là-bas, j’entends encore la voix lasse et je revois le geste vague – une main moulinant dans le vide, reliée à un bras accoudé et à un corps parfaitement immobile – du directeur de la mobilité internationale du Groupe Icare, me signifiant qu’il n’avait pas d’autre conseil à me donner pour partir là-bas, bien au-delà du quartier de La Défense et du périphérique, tellement au-delà de la France et de l’Europe… Alors, me voici dans la « ferme » d’un prince, autrement dit un palais au milieu d’une palmeraie. Ne le négligez pas, c’est un partenaire stratégique ! En apparence, pas de cérémonie ni de signes distinctifs indiquant la position sociale des uns et des autres. Mais chacun connaît son rang et le rang des autres, chacun se surveille, de telle sorte que l’ambiance décontractée du début devient peu à peu factice, puis de plus en plus pesante au fur et à mesure que l’ennui s’installe. Une tente a été dressée entre les palmiers ainsi qu’une douzaine de tables de dix couverts. Au centre des tables, un énorme tas de riz écrasé par un demi-mouton entouré d’une multitude de poulets grillés. Chacun s’assoit selon la proximité sociale supposée. Après avoir intensément observé les hommes en blanc et mémorisé certains visages, je me joins au groupe du Libanais. Pour se faire une idée du repas, il faudrait jeûner pendant une semaine. Ça arrache des pattes, ça fouille dans la graisse, ça déchire la chair, ça fait voler du riz, ça éructe et ça se calme en quelques minutes. Soudain, alors que je tiens victorieusement une épaule de mouton arrachée de haute lutte de ma seule main droite, le prince se lève et tout le monde en fait autant d’un même mouvement. Je laisse à regret mon os et nous allons nous asseoir sur un immense tapis étalé devant un téléviseur géant posé à même la pelouse. Le prince, télécommande en main, s’assoit en face et chacun fait de même de part et d’autre du royal zappeur. On boit du thé, on fume, on se tait. Seul le prince échange quelques mots avec son voisin de gauche, un autre prince, puis avec son voisin de droite, prince aussi. Mais, soudain, il se tourne vers moi et me lance en français : Ainsi, vous travaillez pour le Groupe Icare ? Vous êtes directeur ? – Non, chargé de développement, et ne sachant trop comment l’appeler, j’ajoute en hésitant un peu : Monsieur le prince, parce que je venais de me souvenir de la rue Monsieur le Prince à Paris. Ah ? Et le prince se remet à zapper. Les autres qui n’ont rien compris à cet échange me regardent avec autant de suspicion et d’envie que si nous venions en quelques mots de conclure une affaire de plusieurs milliards. L’après-midi de ce même jour a eu lieu un attentat à Riyad. Une voiture kamikaze s’est fait exploser devant le ministère de l’Intérieur. Huit morts, plus de cent blessés. Sur les différentes chaînes saoudiennes défilent en boucle les images des dignitaires au chevet des victimes. Le ministre de l’Intérieur, le prince Nayf, a droit à la plus grande part du journal. Un moment, on voit un pauvre type entubé et apparemment brûlé à la tête, autour duquel s’affairent quatre infirmières. Un policier les bouscule violemment pour permettre au ministre de poser devant le malheureux qui peut-être ne se remettra pas de cet instant sans soin. En regardant ces images, les hommes en blanc s’animent, les uns d’indignation devant cette violence aveugle, les autres de colère contre les puissances étrangères forcément derrière tout ça. Mais surtout, je sens circuler dans l’assistance une onde d’impuissance et un frissonnement de peur. Et, comme pour fuir ces images, le prince se lève et attaque au pas de charge sa promenade du soir. Tout le monde l’imite et nous voilà déambulant dans la palmeraie à un rythme infernal. Le rang des uns et des autres, brouillé lors des présentations et peu clair durant le repas, apparaît soudain, nul ne commettant l’affront de se mettre devant plus élevé que lui, de telle sorte que c’est bien une cour qui court après le prince. Les plus obèses peinent à suivre mais pour rien au monde ne laisseraient un inférieur leur passer devant ; les roturiers, derniers de la troupe, se moquent bien de ces préséances puisque personne ne risque de les dépasser. Alors, avec le Libanais, nous nous amusons à marcher sur les talons des gros hommes en blanc qui, se sentant rattrapés par les uns et distancés par les autres, se mettent à trotter péniblement pour ne pas perdre de vue le prince et ses proches qui s’enfoncent dans la palmeraie mal éclairée.
* * *
Que pouvez-vous faire pour moi ? Celui-ci parle sans discontinuer depuis qu’il est entré dans mon bureau. C’est un Marocain au regard fuyant et aux gestes nerveux. Le désaccord entre son visage lisse et ses cheveux grisonnants empêche de lui donner un âge. Il flotte dans les eaux incertaines de la vie, ni jeune ni vieux, littéralement hors d’âge. Avant même de s’asseoir, il s’est mis à parler avec le ton monocorde et saccadé de ceux qui sont restés solitaires ou enfermés trop longtemps. Leur parole se reconnaît immédiatement, elle ne se cale pas sur celle de l’interlocuteur, elle se connecte au monde intérieur. J’assiste à ce monologue en retrait, avec l’impression très nette que cet homme a poussé ma porte comme on ouvre une parenthèse. Il n’y a rien d’autre à faire que se taire, devenir l’oreille que cette bouche est venue chercher, recueillir ce fragment d’humanité et attendre tranquillement que la parenthèse se referme. Il dirige depuis dix ans un hôtel au milieu du désert, dans une petite ville près d’un site archéologique. C’est un bel hôtel, chambres spacieuses, salle de restaurant sous coupole de verre, buffet varié, vue sur les montagnes. Il va chercher lui-même les clients à l’aéroport de Médine qui se trouve à quatre cents kilomètres de son hôtel. Avec sa propre voiture, car les clients sont peu nombreux, et peu souvent car les clients sont rares. Depuis dix ans qu’il dirige son hôtel, il se souvient de ses clients comme une maîtresse de maison dans un village reculé se souvient de chacun de ses invités. Il a déjà eu un groupe de douze personnes mais cet événement ne s’est jamais reproduit. La plupart du temps, ses cent vingt chambres restent vides. Le propriétaire, un prince, exige cependant que le personnel s’active comme si l’hôtel affichait complet. On fait le ménage, on change les draps, on astique les salles de bain, on passe en revue tout l’hôtel, et le soir on jette à la poubelle la cuisine la plus raffinée. Chaque jour se rejoue la même comédie comme si on était à la veille d’une arrivée massive de clients à jamais fantomatiques. D’abord satisfaits du rôle de figurants qu’on leur imposait, les employés se sont rapidement mis à rêver d’avoir trop de clients, puis se sont résignés et travaillent désormais comme des automates, devenant eux-mêmes des ombres au service des ombres. On entend des pas, des voix qui chuchotent, des objets qui tombent, mais on se rencontre de moins en moins dans les couloirs de l’hôtel comme si à force d’œuvrer dans le vide et au lieu de se chercher pour se distraire, les hommes finissaient par s’éviter, n’ayant plus rien à se dire, plus rien à échanger, comme si le vide lui-même les avait pénétrés pour ne laisser d’eux qu’une enveloppe mobile et sans âme. L’un s’est enfui, un autre s’est mutilé, certains parlent tout seul, la plupart ont la tête basse, le regard absent, le geste mécanique. C’est un équipage de spectres aux commandes d’un vaisseau fantôme. Le directeur se sent un peu responsable de ce délabrement humain, mais que peut-il y faire ? Il n’y a pas de client et il n’y en aura pas. Le prince perd de l’argent mais sa fortune lui permet le luxe de s’auréoler du glorieux titre de propriétaire d’un grand hôtel. Que pouvez-vous faire pour moi ? Et le directeur a posé sa carte sur mon bureau, s’est levé sans bruit, a glissé sa main froide dans la mienne, et la porte s’est lentement refermée derrière lui.
* * *
Abou Ali ne connaît pas son âge exact, il a plus de soixante ans et moins de quatre-vingts. Il est l’un des derniers survivants d’une antique lignée de pisteurs du désert, la tribu Al-Murrah du Sud et de l’Est de l’Arabie. Enfant, son père l’envoyait chercher les chameaux égarés, il devait connaître chacun d’eux et, à la seule vue d’une trace dans le sable, être capable de déterminer si l’animal était des leurs ou pas, s’il était repu, assoiffé ou malade. Il a appris auprès des vieux à connaître les cinq mille points de pression qui se combinent dans une trace de pied humain. Même une empreinte de doigt ne parle pas autant qu’une trace de pied. Il peut savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, il peut y lire son âge, sa taille, son poids, sa condition physique, sa tribu, et même son caractère. Il peut dire d’une femme si elle est enceinte ou si elle est vierge. Dans les traces d’un animal il voit la bête entière, dans les traces d’un homme il voit son visage. Il ne sait ni lire ni écrire mais le désert entier est pour lui un livre immense, le sable est rempli de présences, il n’est jamais seul quand il s’y promène. Un jour, on lui a demandé de pister un criminel. Malheureusement, après plusieurs kilomètres, l’homme a pris la fuite à bord d’une voiture. Trois ans plus tard, alors qu’il se rendait à la prière, un coup d’œil sur les chaussures à l’entrée de la mosquée lui a suffi pour reconnaître les sandales de l’homme recherché. La police l’appelle régulièrement, mais les hommes marchent de moins en moins dans le désert. Son fils promettait, il commençait à distinguer les différents âges d’un individu mais il n’a pas continué son apprentissage. Il a dit à son père qu’une femme ne voudrait pas d’un pisteur qui passe sa vie le nez au sol comme un serpent. Abou Ali l’a sorti de force de la maison. Va, marche, puisque tu es un homme et que je suis un serpent ! Le fils est parti, et dans les traces de ses pas Abou Ali a vu un fils timide, apeuré, honteux, et peu à peu le fils s’est effacé pour laisser place à un homme plus déterminé, puis plus loin ses traces ressemblaient à celles des habitants des villes, lourdes et maladroites, et son fils est devenu un étranger, un homme sans histoire, sans tribu, sans père, et Abou Ali a su que ses pieds ne porteraient plus jamais le monde qui meurt doucement sous les siens.
© Éditions de l’Olivier
Quelques suggestions de lecture:
- Kouchner, une confusion de quelle origine?
- Ikea en Arabie Saoudite : quand adaptation rime avec contradiction
- Risques interculturels: le cas de l’Arabie Saoudite 3
- L’Arabie saoudite pour les nuls (ou petite leçon de saoudologie à l’usage du sénateur Philippe Marini)
- Chaque usage a sa raison – ou leçon de Montaigne sur le voyage et la rencontre avec l’autre
- Comment portez-vous la cravate?
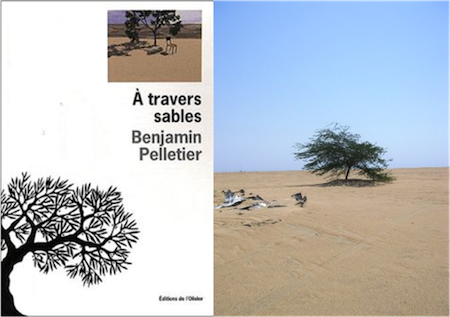


Derniers commentaires