Une équipe d’auditeurs du MBA exécutif MSIE de l’École de Guerre Économique (Palissandre Bert Ngayila Doussin, Jérémy Grammatica et Damien Lorinet) devait recueillir une situation interculturelle en contexte professionnel et l’analyser en s’appuyant sur des ressources bibliographiques et des entretiens.
Dans cet extrait de leur travail, vous trouverez le récit de l’incident (les prénoms ont été changés et tout élément permettant d’identifier l’entreprise a été retiré) et quatre extraits des entretiens qu’ils ont menés avec Heroshini Komali Ramadugu, Gaël de Graverol, Sunita Nichani et Philippe Pierre. Ils apportent des éclairages précieux par la diversité de leurs profils et réflexions.
Remercions-les d’avoir accepté de rendre publics ces entretiens, ainsi que les auditeurs qui ont fait cet effort essentiel d’aller recueillir des retours d’expérience et de l’expertise pour donner du sens à une situation très spécifique. C’est là une démarche clé de l’intelligence économique : recueillir de l’information culturelle utile par le renseignement humain de source ouverte.
* * *
Récit de l’incident
Installé depuis dix ans au Royaume-Uni et d’origine franco-gabonaise, Daniel est manager d’une équipe d’ingénieurs informatiques internationaux, L’équipe est responsable du développement et de la maintenance de plusieurs applications en production.
Kumar, ingénieur indien, avait été désigné par le chef d’équipe Arjun, également indien, pour prendre en charge le déploiement d’un logiciel. Récemment arrivé et peu expérimenté sur l’application déployée, Kumar a accepté la tâche sans demander d’aide ni à être formé.
Début 2025, le logiciel tombe en panne. Les investigations pointent vers une mauvaise configuration lors du déploiement de sa dernière version. Durant le processus de correction, il s’avère que Kumar a commis des erreurs ayant mené à la panne, mais il refuse de l’admettre et rejette la faute sur ses collègues.
Après résolution du problème, Daniel rassemble son équipe pour une réunion post-mortem. Kumar finit alors par reconnaître implicitement ses erreurs. Il explique avoir craint de demander à ses collègues comment procéder.
C’était une attitude récurrente que Daniel avait observée de la part des collaborateurs indiens. Il a donc demandé que ces derniers reçoivent une formation axée sur la communication et le besoin de transparence. Il a aussi mis en place des « safe spaces » (des espaces de communication sécurisant) pour libérer la parole en évitant que les personnes concernées ne se sentent jugées.
Lors des mission suivantes, il a également changé le processus de désignation des responsables de projets, notamment en responsabilisant plus de personnes afin de minimiser le risque d’erreur.
1. “J’ai déjà vu des situations similaires”

Heroshini Komali Ramadugu est une professionnelle aux expériences multiples en Inde, où elle a exercé différents métiers, notamment comme présentatrice TV et cheffe de projet.
Quelles ont été vos premières pensées en découvrant ce cas ? La réaction de Kumar vous semble-t-elle familière ?
— Franchement, ma première réaction a été : « Cela semble très réaliste. » La réaction de Kumar ne m’a pas surpris du tout, car j’ai déjà vu des situations similaires. En Inde, beaucoup d’entre nous ont tendance à considérer les tâches au travail comme une obligation plutôt que comme une responsabilité personnelle. Nous faisons souvent quelque chose parce qu’un manager ou un supérieur l’attendent de nous, pas nécessairement par appropriation individuelle. Ainsi, lorsqu’un manager issu d’une culture différente s’attend à de l’ouverture, de l’initiative ou de l’autonomie, cela peut sembler inconfortable, voire intimidant.
Selon vous, quelles sont les principaux enjeux interculturels dans ce cas ?
— Le plus important, à mon sens, est la hiérarchie. En Inde, elle est profondément ancrée. Elle influence la manière dont nous parlons à nos enseignants, à nos parents, et plus tard, à nos managers. Cela dépend totalement de l’éducation et de la scolarisation que nous avons reçues. Si vous avez grandi dans un environnement où remettre en question l’autorité était découragée, vous reproduisez naturellement ce comportement au travail. Au Royaume-Uni, la hiérarchie existe, mais elle est souvent moins marquée : les employés sont encouragés à prendre des initiatives, à s’exprimer et à partager leurs idées plus librement. Une autre différence concerne la communication : en Inde, on communique souvent de manière indirecte pour préserver l’harmonie, tandis qu’au Royaume-Uni, les gens ont tendance à être plus directs (tout en restant polis
Selon vous, dans quelle mesure le système des castes influence-t-il la vie en entreprise ?
— Je dirais que le système des castes a moins d’influence dans les entreprises internationales ou urbaines. Par exemple, le type de scolarité que vous avez reçu, ou le fait d’avoir eu accès à une éducation en anglais, peut parfois être lié à la caste et au milieu social. Cela affecte ensuite la confiance en soi dans un environnement professionnel mondialisé. Dans la vie quotidienne des multinationales, la méritocratie prend le pas, donc l’influence du système des castes est minime. Il peut encore jouer un rôle dans le secteur public, où des quotas et des réservations existent, mais dans le privé, c’est plus subtil — peut-être psychologique, en termes de confiance ou de conditionnement social, mais pas vraiment au niveau administratif ou politique.
Quelle est l’attitude envers les erreurs dans la culture indienne ?
— Les erreurs sont souvent perçues comme quelque chose de honteux : on évite de les admettre ouvertement, car cela pourrait faire « perdre la face » devant ses collègues ou son supérieur. En grandissant, beaucoup d’entre nous ont appris à ne pas échouer, et les erreurs étaient corrigées par des punitions plutôt que par de l’encouragement. Cette mentalité se retrouve dans la vie professionnelle, où les gens ont tendance à cacher ou minimiser leurs erreurs au lieu de les considérer comme une partie naturelle de l’apprentissage. Il y a aussi une forme de complexe d’infériorité : on se sent souvent jugé avant même de poser une question, car demander quelque chose ou ne pas comprendre immédiatement est parfois considéré comme une faiblesse. En revanche, au Royaume-Uni, les erreurs et les questions sont perçues de manière plus positive, comme des éléments de croissance et de curiosité — ce qui est rafraîchissant.
2. “Il est important d’avoir un discours pédagogique sur l’erreur”
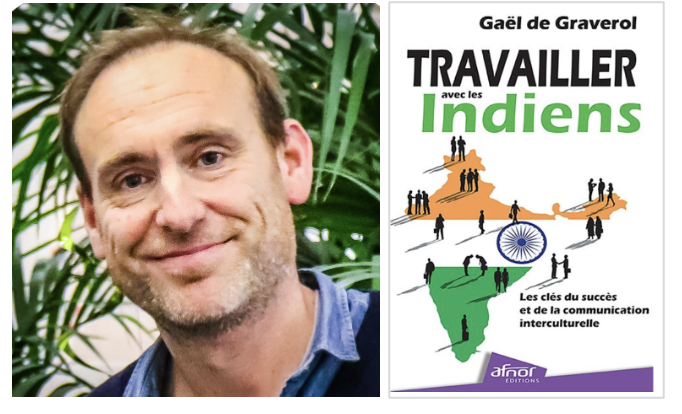
Gaël de Graverol est docteur en anthropologie sociale et formateur interculturel spécialiste de l’Inde et plus généralement de l’Asie du Sud. Il conjugue deux champs professionnels complémentaires pour proposer des formations interculturelles et conférences dans le cadre de l’entreprise : ethnologie et management interculturel. Il publiera Travailler avec les Indiens le 22 janvier 2026 aux éditions AFNOR.
Quels facteurs culturels identifiez-vous dans ce cas ?
— Kumar ayant grandi et été éduqué en Inde, son « logiciel », ses codes et ses réflexes sont avant tout informés par le système de valeurs indien. Sa relation à la hiérarchie est ainsi verticale et corsetée, un biais qui commence dès l’école où les enfants sont plus encouragés à développer leurs facultés de mémorisation, que leur propre esprit critique. En outre, de nombreux instituteurs y pratiquent encore des punitions ou humiliations corporelles malgré leur interdiction par la loi. Ce type de pédagogie et de traitements conditionne chez les jeunes indiens une vision de l’autorité plutôt discrétionnaire, arbitraire et punitive. Or l’instituteur représente toujours la première figure d’autorité que nous rencontrons hors du noyau familial. Elle en forme le prototype. En sorte que lorsque les jeunes Indiens entrent sur le marché du travail, quand ils sont confrontés à leur manager, ils se trouvent ramenés à leurs peurs archaïques : celles de ne pas savoir, de se tromper ou encore de prendre des initiatives qui les exposeraient au regard critique du supérieur hiérarchique. Kumar vit cette situation avec appréhension face à Arjun et Daniel. Aussi préfère-t-il taire son incompétence afin de passer sous le radar de la critique.
Comment dépasser cette inhibition ?
— Les Indiens sont plus axés « personnes » que « tâches ». Une relation de proximité entre Daniel et Kumar, prérequis incontournable à la création d’une confiance mutuelle, semble avoir fait défaut dans ce contexte. Daniel a probablement géré ce projet trop à distance ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’une visibilité suffisante sur le travail de Kumar. Il s’en est trop remis à Arjun. A l’inverse, la démarche consistant à chercher à personnaliser ses rapports avec ses collaborateurs indiens aurait probablement permis à Kumar de sortir d’une posture stéréotypée vis-à-vis de Daniel, celle d’exécutant face à un donneur d’ordre ou de «servant-master ». Il est donc essentiel de gagner progressivement la confiance de collaborateurs indiens via des échanges plus informels et personnalisés et ce dès les premières rencontres. S’autoriser à faire un pas de côté par rapport aux questions purement opérationnelles, partager, dans la mesure du possible, des moments « extra-professionnels » (à travers des sorties hors du bureau par exemple, ou encore des séquences de team building ludiques) : tous les échanges permettant à des collaborateurs sud-asiatiques de découvrir la personne « de chair et de sang » derrière la figure du manager étranger.
Quelles recommandations feriez-vous afin de prévenir ces écueils ?
— D’une manière générale, je conseille aux professionnels qui travaillent avec des Indiens d’éviter de leur poser des questions fermées, lesquelles acculent trop souvent les collaborateurs indiens à une réponse stéréotypée : celle qu’ils pressentent que l’interlocuteur attend d’eux et qui leur permet de sauver la face. En ce sens un « Oui, je peux », un « yes, Sir » pourraient en réalité cacher une incompétence ou une véritable impossibilité. Je recommanderais plutôt de privilégier des questions ouvertes telles que « comment » ou « avec qui », « pour quel motif, à quelle fin ? ». Dans la situation qui est celle de Daniel, avoir pris le temps au préalable de s’intéresser à Kumar, de faire connaissance afin d’entrer « en résonance » avec lui aurait sans doute eu pour conséquence directe de davantage libérer la parole de Kumar. A défaut, ce dernier s’est ici certainement senti livré à lui-même, sans cadre et sans repère. Aussi aurait-il été également nécessaire d’établir avec lui un retroplanning plus serré afin de jalonner l’avancement du projet et de multiplier les points de contacts entre Daniel et Kumar. On comprend, en d’autres termes, que les équipes indiennes se pilotent de près.
Et qu’en est-il du rapport à l’erreur ?
— Étant donné la peur légitime que les employés indiens peuvent éprouver à l’égard de leur manager, lesquels ont, à l’instar de leurs subordonnés, intériorisé le même modèle de management « à l’intimidation » caractéristique du système scolaire sud asiatique, les collaborateurs indiens vont avoir tendance à passer leurs erreurs sous silence afin d’éviter les critiques trop acerbes. Il est donc à cet égard important, d’une part d’avoir un discours pédagogique sur l’erreur, et d’autre part d’éviter les projections hâtives sur les agissements du collaborateur indien liées à son propre filtre culturel : celles qui aboutissent à identifier une tromperie ou une fourberie dans le silence de l’interlocuteur indien sur ses erreurs, ses doutes ou ses lacunes. A céder trop vite à son humeur, à invectiver le fautif et blâmer son inconséquence on risque surtout de majorer la peur de la réaction du supérieur hiérarchique. Cela nuira plus encore à la communication. Daniel devrait dès lors avoir une discussion individuelle avec chacun de ses subordonnés indiens et tenir un discours positif sur les vertus de l’erreur : on apprend de ses erreurs, faire la distinction entre erreur et faute professionnelle…, tout le monde fait des erreurs, quel que soit son niveau hiérarchique… L’infaillibilité n’existe pas et ne saurait être exigé d’un collègue. A l’inverse, la fiabilité de la parole de celui qui commet une erreur n’est pas négociable. D’où il est important que toute lacune, faute ou échec soit remonté au niveau du supérieur hiérarchique.
Comment aborder les sujets critiques alors ?
— En France, le mode d’expression des critiques est basé sur le renforcement négatif : insister sur ce qui ne va pas et considérer que ce qui est bien va de soi. Face à un interlocuteur indien, il faudra plutôt formuler son grief de façon à ce qu’il ne soit pas vécu comme une attaque frontale qui braquerait l’interlocuteur. Il est important d’être conscient de ses propres biais culturels et de son relatif franc-parler. Par conséquent, on privilégiera une formule telle que « nous avons un problème » à « vous » ou « tu as un problème ». Un tel procédé rhétorique consistant à mutualiser la responsabilité de l’échec, et donc à éviter la mise en accusation du collaborateur, permettra de mieux libérer la parole de ce dernier pour obtenir en retour plus de transparence et de franchise de sa part.
Est-ce que la perception du collègue “occidental” peut jouer dans cet événement ?
— Rappelons que les Indiens ont connu une très longue colonisation, débutée dès le XVIe siècle. Sous ce rapport, les quelque 78 années qui nous séparent aujourd’hui de la fin de cette longue page d’histoire n’ont pas effacé les affres de la colonisation de la mémoire indienne. Bien que les Indiens se montrent le plus souvent magnanimes à l’égard des Occidentaux s’agissant de ce lourd passif, il n’est donc pas exclu qu’un professionnel sud-asiatique, confronté à une critique perçue comme trop acerbe de la part d’un manager occidental, puisse réagir de manière virulente. Le fait est que le lien hiérarchique entre supérieur et subordonné est en effet susceptible de faire écho au rapport asymétrique colonisé/colonisateur. Ce sera particulièrement le cas si une situation est vécue comme une injustice par le partenaire indien. Or se voir catalogué dans la catégorie du néocolonialiste arrogant est une situation très contreproductive pour le manager qui souhaiterait à l’inverse résoudre une difficulté ou lever un blocage. Elle n’engendrerait que complications et tracas supplémentaires. D’où l’importance de savoir pondérer ses critiques et de prendre des précautions de langage.
3. “Pour les Indiens, leur erreur est ressentie comme un désastre”
Sunita Nichani est une consultante indienne en interculturalité. Elle a animé de nombreuses sessions de formation avec des Indiens et des équipes européennes.

Après lecture du récit du cas, la réaction de Kumar vous semble-t-elle familière ?
— Je rencontre souvent des « Kumar » au quotidien. La réaction de Kumar est plus une action de protection que de contestation. Sans relation de confiance, il est difficilement acceptable d’être critiqué devant l’autre. Il est vrai qu’en Inde, l’adage « une faute avouée est à moitié pardonnée » n’existe pas. On dit plutôt que « les gens qui avouent leur erreur le font avec beaucoup de frissons » et c’est valable dans bien d’autres contextes. Car souvent la personne à qui on l’avoue, l’accepte difficilement. Plus on gravit les échelons au sein de l’organisation, plus le sentiment de préservation de la face est prégnant. Cela est plus remarquable auprès de l’ancienne génération, la nouvelle génération de professionnels indiens est plus transparente.
Le mode de communication utilisé par Daniel correspondait-il à la situation ?
— Kumar a été désigné par Arjun qui savait pertinemment que ce dernier n’était pas suffisamment expérimenté pour le déploiement de l’application. Kumar s’est certainement retrouvé dans une situation difficile. En effet, une tâche lui était confiée sans aucune directive claire. Et lui-même n’a pas trouvé le courage de demander des explications. Il a donc fait de son mieux en ne sachant pas vers qui se tourner pour obtenir des informations. Ce qui a indubitablement engendré une erreur (faute). Sa vérité à lui, c’est que les autres ne lui ont pas transmis l’information. De plus, sa récente intégration au sein de l’équipe, ne lui a pas permis de se familiariser correctement avec l’application.
Selon vous, et avec des lunettes plus ou moins neutres, quels sont les facteurs culturels qui vont impacter les relations professionnelles entre Indiens et Français ?
— Du côté français, il y a, premièrement, la notion de hiérarchie dont la conception diffère totalement de chaque côté. Ensuite, le regard des Français envers leurs collègues indiens, est fortement influencé par la notion de castes et autres. Ce qui biaise leur interprétation des interactions. En effet, une simple relation ou un échange vont être analysés sous le prisme des castes. Ce qui n’est pas toujours le cas, surtout en entreprise et en contexte international. Les Français ont également un problème avec la perception indienne de l’évolution de carrière. Ils estiment que leurs partenaires indiens sont obnubilés par l’ascension professionnelle et l’accession rapide aux postes de responsabilités. Plusieurs collègues français me disent : « Au bout d’un an, ils veulent être promus. Nous, nous faisons ce métier depuis des années, eux, ils viennent d’arriver et ils pensent déjà être experts en tout ». Ce qu’il faut comprendre, c’est que la culture indienne porte sur un certain piédestal ceux qui arrivent à se hisser au sommet de la hiérarchie, en occupant des postes de direction. C’est très important d’un point de vue social. Obtenir un poste important peut changer la vie sociale d’un individu. Il peut trouver une meilleure épouse, être un motif de fierté pour sa famille, etc.
La différence au niveau du rapport à l’erreur entre Français et Indiens rend-elle les relations professionnelles plus complexes ?
— Du côté indien, un collègue français peut être perçu comme une personne assez rigide, facilement encline à répondre par la négative et qui n’écoute pas pour s’adapter. Pour les Indiens, leur erreur est ressentie comme un désastre et une compétence moindre par rapport à celle des Français : « Ils pensent que nous sommes moins bons juste parce qu’on a fait une erreur ». Les équipes indiennes ont tendance à prendre leur temps afin de mieux comprendre ce qui leur est demandé et de pouvoir le faire correctement. C’est la période de lancement du projet qui est souvent complexe à gérer. C’est assez stéréotypé de dire que les Indiens n’aiment pas reconnaître leurs erreurs. Kumar n’avait peut-être pas toutes les cartes en main. L’erreur provient donc du mauvais chef d’équipe. Chercher le coupable de l’erreur sans chercher à connaître le pourquoi de cette erreur, c’est fréquent. J’entends souvent des Kumar, et j’entends aussi souvent leurs émotions, et leurs émotions c’est de la douleur.
Comment arriver à déceler les obstacles culturels ? Quelle est la bonne approche ?
— Il faudrait favoriser les collaborations en présentiel, encourager et mutualiser les échanges sur sites distincts. Cela permet de décrisper les interactions, même si ce n’est pas toujours pratique. On pourrait aussi organiser des séances de team building avant de se lancer dans la phase pratique du projet. Trouver du temps pour des échanges de savoir-faire, pour pallier le déséquilibre en termes de connaissances de procédés, et clarifier les processus, les modes de travail et de communication. Enfin, il convient d’organiser très régulièrement des points d’étape.
4. “Se méfier des liens de causalité associés à un pays”

Philippe Pierre est docteur en sociologie et expert en management interculturel. Il est un penseur important de l’intergénérationnel, du management des talents, de l’organisation apprenante et de ses multiples transformations humaines. Dernier ouvrage paru : L’Abécédaire de l’interculturel, co-écrit avec Michel Sauquet.
Après lecture du récit du cas d’étude qui vous a été soumis, avez-vous été surpris par la réaction de Kumar ?
— Oui, je pense que cela fait partie des chemins qui peuvent expliquer son comportement. En effet, il y a trois grands facteurs qui vont interagir lors de l’analyse d’une situation multiculturelle. Le premier c’est ce que j’appellerai le domaine des cultures d’origine au pluriel. Et à ce stade, bien évidemment, l’expérience de la colonisation, de la décolonisation, sa scolarité, vont influer sur son référentiel culturel, son référentiel de sens. Le second, c’est la culture du pays d’accueil, de la région d’accueil, et quelques fois de la ville d’accueil. En management interculturel, nous avons été très influencés par le régime westphalien, c’est-à-dire des États-nations. Et la majorité des travaux a porté sur l’établissement d’une connexion entre une appartenance nationale et un supposé comportement
Il faut donc analyser d’autres niveaux que la seule dimension nationale ?
— Tout à fait. Au fil du temps, je me suis aperçu qu’il y avait, à l’intérieur d’un pays, des dissemblances qui pouvaient être plus prononcées, entre l’urbain, le périurbain et le rural. En résumé, c’est le contexte dans lequel, il va, lui (Kumar), déployer son action.
Quel serait le troisième facteur alors ?
— C’est la culture de l’organisation qui l’emploie, qui va également façonner un segment de son comportement. Et tout cela en appelle alors à une notion qui me passionne énormément, celle du “bricolage identitaire”. Cette thématique a d’ailleurs fait l’objet de toute mon attention, car elle fait référence à des situations au cours desquelles des personnes utilisent des fragments d’histoire personnelle pour essayer de conquérir du pouvoir en situation. En d’autres termes, c’est jouer à être étranger pour conquérir du pouvoir. Manipuler en situation son ethnicité…
C’est-à-dire ?
— C’est un peu comme si une personne jouait, dans certaines situations, à être indien, et dans d’autres, à être dans une filiation britannique intellectuelle, et dans une troisième, un individu qui va s’efforcer de rester en situation neutre. Nous sommes toujours plus que ce que les autres nous disent que nous sommes. Il y a ce que je revendique subjectivement et il y a ce que les autres m’accordent socialement, c’est mon parcours de sociologue qui m’amène à penser comme ça. Il faut toujours se méfier des liens de causalité associés à un pays.
Selon vous, quels facteurs culturels avez-vous pu déceler concernant la relation avec les Indiens dans ce cas précis ?
— Concernant, les orientations du professeur Gaël de Graverol, que vous avez interviewé, je dirais que nous, Européens, avons effectivement tendance à prioriser les tâches plutôt que la personne. Et c’est vrai qu’en Inde, il faut vraiment s’intéresser à la personne avant d’entrer dans le vif du sujet. J’aurais tendance à dire : à la personne et puis à son inscription communautaire, c’est-à-dire les liens que cette personne tisse. Il y a des pays au sein desquels les découpages ethniques sont aussi des découpages statutaires. Par ailleurs, il faut savoir que les grandes entreprises internationales ne sont pas du tout dans une logique d’anonymisation du rapport à l’autre. Elles sont parfois à l’écoute des droits et des devoirs qu’on octroie en fonction de l’appartenance. Dès lors, il faudrait placer la personne dans ce que j’appellerais « un archipel de relations ». Et cela me semble primordial.
Pourrions-nous avoir votre avis sur la question de la verticalité de la hiérarchie, aussi bien du côté occidental que du côté asiatique par rapport au présent cas ?
— Je pense qu’un Occidental sera souvent surpris des contournements de positions statutaires qui lui semblent tout à fait officielles. Par conséquent, il y a des relations amicales qui vont primer souvent sur la relation statutaire. Je l’ai constaté en Asie, je l’ai constaté en Afrique. On peut même l’observer au Pays basque, en Alsace et chez les Aveyronnais. En d’autres termes, la terre natale se mue en un substrat d’appartenance très intense, modelant nos choix de vie, l’allocation de nos moyens et le déploiement des ressources économiques.
Quelques suggestions de lecture:
- L’absurde lucidité de certaines entreprises sur leurs défaillances interculturelles
- Aux frontières du réel (quand une carte met en péril une négociation)
- De l’influence des mythes sur la pratique des affaires : le point de vue d’un Indien
- L’effet de surprise, ennemi de la communication interculturelle
- 4 exemples d’exotisme linguistique (petites laideurs et grosses erreurs)
- Comment les étrangers perçoivent-ils leurs partenaires français ? (intervention au colloque des CCE)
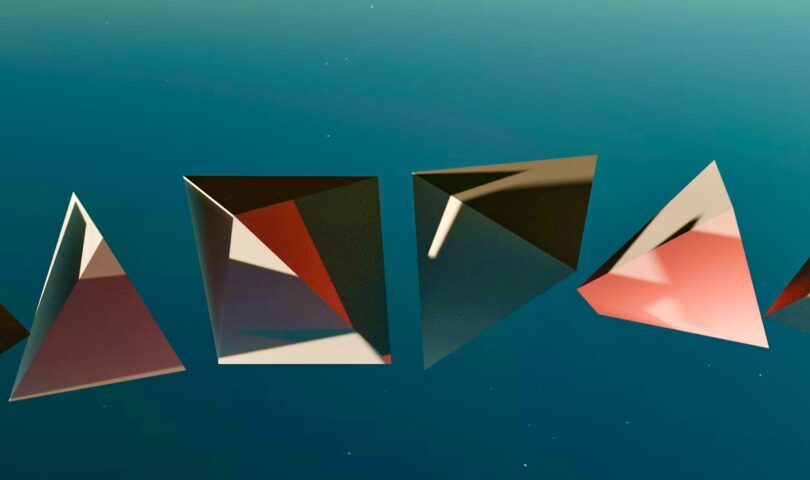


Derniers commentaires